24/05/2017
KR'TNT ! ¤ 330 : THEE OH SEES / T-SHIRT / POGO CAR CRASH CONTROL / SCORES / '77 / NEW ROSES / HOWLIN' JAWS / AUSTIN OSMAN SPARE
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME
LIVRAISON 330
A ROCKLIT PRODUCTION
25 / 05 / 2017
|
THEE OH SEES / T-SHIRT POGO CAR CRASH CONTROL SCORES / SEVENTY SEVEN / NEW ROSES HOWLIN' JAWS / AUSTIN OSMAN SPARE |
TEXTES + PHOTOS SUR
http://chroniquesdepourpre.hautetfort.com/
I can see Thee Oh Sees (for miles and miles)
Sur scène, Zi Oh Sees développent une telle énergie qu’on pense aux Who. Tous ceux qui ont vu les Who sur scène le savent : aucune équivalence dans l’histoire du rock, aux plans présence et niveau sonore. Pas même Motörhead. Avec sa nouvelle formule de powerhouse à deux batteurs, John Dwyer renoue avec la démesure du Baba O’Rhum cataclysmique qui nous avait explosé les tympans à la fête de l’Huma en 1972.
Tiens, encore un point commun avec les Who : John Dwyer joue sur une bête à cornes, comme Pete Townshend, sauf que la sienne est transparente. Et comme Pete Townshend, John Dwyer multiplie sur scène ce que les Anglais appellent the antics. Dwyer ne saute pas en moulinant comme Townshend, mais il exécute des pas de danse abyssiniens, ceux du Nijinski de l’Après-Midi d’Un Faune, très graphiques et joliment dingoïdes, pour bien ponctuer l’envoi des violentes rafales de chaos sonique. Il va très loin, bien au-delà du spectaculaire. Comme les Who, il échappe à tous les formats, parce qu’il a su bâtir un monde à son image, celle d’un blaster quasi-incontrôlable.
Tous ceux qui ont vu les Dirtbombs et les Monsters le savent : sur scène, la double batterie démultiplie l’impact du groupe. Mais on a l’impression que les mighty Oh Sees atteignent un niveau encore supérieur de démesure, car rien de ce qu’ils jouent n’est prévisible. Leurs albums produisent exactement le même effet. Ils sont à la fois tellement libres et tellement puissants qu’ils échappent à toutes les conjectures, et sur scène, l’imprévisibilité des choses fait tout le charme du groupe. Ça veut dire en clair que John Dwyer nous emmène exactement là où il veut. Il manie une sorte de chaméléonisme impénitent qui lui permet de créer la surprise en permanence. D’où l’I can see for miles and miles and miles and miles, d’où cette facilité psychédélique à pulvériser les attentes, d’où cet immoralisme sonique qui se moque des lois de la République, d’où cette volcanisation des thèmes que les instituts de recherche ne parviennent toujours pas à interpréter, d’où cette exubérance intempestive qui ridiculise les tempêtes du Cap Horn, d’où cette manie des irruptions insoupçonnables qu’on accueille à bras ouverts, d’où cette facilité dégueulasse à réinventer le rock, et même pire, à rocker la ré-invention. John Dwyer est un homme à mille facettes. On imagine aisément que les êtres qu’on déifiait dans l’antiquité devaient lui ressembler. Il s’impose par une sorte de charisme à la fois bon enfant et mèche dans l’œil, mais une sorte de rigueur monastique semble charpenter le personnage. Il est bien évident que l’infernale qualité de son jeu de guitare ne sort pas de la cuisse de Jupiter. Il joue exactement ce qu’il faut jouer, sans en rajouter. John Dwyer n’est pas l’un de ces Raymond la science qui s’affichent en couverture des magazines de rock qui ont depuis longtemps sombré dans la vulgarité. Tout le contraire. Il arrive sur scène comme s’il revenait de la plage, après une partie de surf à Malibu. Chez lui, pas la moindre trace de rock-starisation. Juste un homme en bermuda avec sa guitare, des idées et trois bons amis (extrêmement brillants, et qui eux non plus ne la ramènent pas).
Justement, on regarde jouer ces deux batteurs et on régale de leur spectacle, de la grâce de leur jeu et de la combinaison de leurs puissances de frappe respectives. Ils jouent tout en parfaite synchronicité, c’est un effarant ballet qui provoque par moments des hallucinations. Ces deux mecs sont beaux comme des apôtres, et de là à voir un Christ en John Dwyer, c’est un pas qu’on franchit avec allégresse dans le feu de l’action. Quand je dis : ces mecs sont beaux, cela veut dire beaux au sens iconique, car les inclinations des visages, le ruissellement des sueurs, les expressions de béatitude, tout cela nous renvoie aux portraits d’apôtres signés par les peintres de la Renaissance italienne. Ces deux batteurs développent une sorte du mysticisme du beat et ne s’accordent aucun repos. John Dwyer veille à ce que leurs batteries soient installées au premier rang. Dès lors, Paul Quattrone et Daniel Rincone jouent à jeu égal avec les deux autres.
Puisqu’on est dans les parallèles, quelque chose chez John Dwyer rappelle Kim Fowley. Sans doute par le dessin très carré du visage, par la carrure, par le fait qu’il soit lui aussi californien, mais surtout par l’ampleur de sa personnalité. Il y a autant de génie chez John Dwyer qu’il y en avait chez Kim Fowley. Ils mettent tous les deux leurs vies et leurs intelligences respectives au service d’une seule forme d’art : le rock. Et on réalise un peu plus facilement que pour parvenir à ce niveau, il faut ce qu’il est convenu d’appeler une prédisposition. Devenir Kim Fowley ou John Dwyer n’est tout simplement pas à la portée de tout le monde. Le rock est un art suprêmement difficile, ne l’oublions pas.
Les débuts du groupe n’auguraient pourtant rien de bon. Essayez d’écouter l’album Sucks Blood paru en 2007 jusqu’au bout, vous verrez, ce n’est pas facile. On trouvait alors ces albums dans le bac garage du Born Bad de la rue Keller et les pochettes piquaient la curiosité.
Une sorte de vampire à six dents ornait la pochette de The Master’s Bedroom Is Worth Spending A Night In paru l’année suivante et on y voyait se développer une tendance intéressante, une façon de penser le rock autrement. En entrant dans cet univers musical, il fallait abandonner tout espoir de rationalité. Sur ce disque, tout n’était que luxe arty, calme incongru et volupté désordonnée. Quand on écoutait un cut comme «Grease 2», on se demandait vraiment pourquoi on écoutait ça. On se demandait aussi à quoi pouvait servir ce groupe inclassable. On les voyait explorer toutes les figures de style inimaginables. En fait, ils nous aidaient à sortir du carcan garage qui finit par appauvrir le rock pour le transformer en peau de chagrin. Avec cet album, Zi Oh Sees se comportaient comme d’impavides stylistes soucieux de diversité. On trouvait en B un commencement de début de hit avec «Adult Acid», un hit de pop rocké du ciboulot. Avec «The Coconut», ils passaient au heavy rock en développant dans les textes une bien belle tendance surréaliste et le «Maria Stacks» d’après finissait par captiver grâce à son Maria Maria you dig a hole with words in there. John Dwyer achevait sa B en beauté avec un «Poison Finger» bien vu, puisque monté sur le riff de «Gimme Some Loving», suivi d’un «You Will See This Dog» gorgé d’I want my fun to be free and out of sight. On ne pouvait qu’admirer la diversité de leurs paysages musicaux. C’est là que John Dwyer commença à façonner le monde à son image de tatouage de main percée et de marcel rayé.
Un jour, on vit une chauve-souris clouée sur la pochette d’un album. Il s’agissait du fameux Help paru un an plus tard sur In The Red qui était alors LE label de référence, comme l’avait été Crypt auparavant. Dès «Ennemy Destruct» on savait à quoi s’en tenir : John Dwyer cherchait à créer l’événement. Il agissait ni plus ni moins comme un bâtisseur d’empire libre, vous savez, ces empires qu’on bâtit pour jouer, un empire d’Everybody dig in everybody clam up et le mythe du monde libre remontait à la surface, sous la forme d’une nouvelle vision du rock, loin du m’as-tu-vu des solistes grimaceurs et des Stong à la mormoille. John Dwyer donnait le champ libre à sa liberté. On entrait alors dans le tourbillon magique de «Ruby Go Home», John y répétait en boucle son Hey tambourine what that you’re saying d’argent gris joué sur un mood de groove garage assez convaincu de sa légitimité. S’ensuivait une belle gerbe d’espoir nouveau avec «Meat Step Lively» gratté à l’insistance typique. Aussitôt après, avec «A Flag In The Court», il réinventait cette belle ferveur surréaliste qui pour son malheur tomba un jour sous la coupe du dictateur Alfred Breton. John Dwyer racontait n’importe quoi, usant de la liberté comme d’un prétexte à toute forme d’expansion du domaine de la lutte. Et la B s’ouvrait comme un horizon, avec «Rainbow», joli coup de mood garage on the move avec les ba ba ba des Troggs dans un refrain scintillant d’arpèges de SG. S’ensuivait un «Go Meet The Seed» solide et terriblement bien intentionné, avec du I wanna hang way up in a tree arrosé de chœurs des Who, et toujours cette manie simplificatrice de répéter en boucle d’argent gris le même couplet en forme d’objet-prétexte. Avec «Soda St#1», il exacerbait encore plus les choses, on avait là un cut élancé, gratté, chant, œuvré, véritablement inspiré par les trous de nez, une sorte de power-pop luminescente. Attention, le festin continuait avec «Destroyed Fortress Reapers», fantastique progéniture picabiesque d’un rainbow qui n’avait pas le droit de dire non, puis tout s’arrêtait brutalement avec «Peanut Butter Oven». On avait là dans les pattes un disque qui sortait de l’ordinaire, un véritable festin d’idées, une gerbe d’éclats protéiformes, on avait la preuve qu’il existait encore un espace pour le libertarisme dadaïsant et tombouctique. Alors, amis des bêtes et de Tzara, du lama rouge et d’Ornicar, jetez-vous sur ce miroir aux alouettes.
John Dwyer confirmait sa pente Dada avec Dog Poison paru la même année. Comme notre homme devenait prolifique, il valait mieux avoir un portefeuille bien garni. Il attaquait avec un «The River Rushes» bien alambiqué et comme toujours sans aucune prétention. Il se payait même de luxe de balancer un solo de flûte complètement délabré. Notons qu’il jouait au seulâbre invétéré sur cet album un peu plus austère que le précédent. Il récompensait la fidélité de ses admirateurs avec «The Fizz», une pop sautillée qui non seulement puait la fuzz, qui avait en plus trouvé l’adresse et qui fell face first at the front door. Cette façon baroque d’amener les choses rappelait bien sûr celle des Holy Moundal Rounders. Avec «Sugar Boat», il fonçait droit sur le ludique barrettien. Mais le Dada se nichait en B avec notamment «I Can’t Pay You To Disappear», un solide romp de pop de so you can do it for free. On ne pouvait pas imaginer plus Dada dans l’esprit. Même chose avec «Voice In The Mirror», pur slab de Dada strut. John stroumphait son Dada stack avec la pire des impénitences ce qui nous permettait d’affirmer à l’époque qu’impénitence et impétuosité constituaient les deux mamelles de John Dwyer. Il enchaînait ce tour de force avec «Dead Energy» joué au processionnaire des fourmis rouges un jour de deuil national. Ça tintinnabulait sous le soleil de Satan.
La pochette abstraite de Warm Slime interloquait. On entrait dans ce monde délicieusement hirsute et créatif par la grande porte, c’est-à-dire le morceau titre, sur une face entière. On entendant la délicieuse Brigid chanter au fond d’un cut qui virait en jam de gym nasty, véritable pied de nez à l’ampoulé du prog. John Dwyer révélait là une passion pour Can, traversant avec nous des paysages chantants et variés. Il jouait littéralement la carte de la face, grâce à un hypno de fête à nœud-nœud, où l’on pêche le canard pour gagner un pingouin. On tombait ensuite sur le festin pantagruélique de la B et cet «I Was Denied» assez comique d’I flew away with a friend of mine et d’I got fucked up suffice to say joué à la ritournelle insistante bien vue, oh see bien vue. Encore plus dingue, cet «Everything Went Black» parfaitement décousu, d’un baroque sans queue ni tête, véritable stomp capable d’envoûter une légion romaine, suivi d’un «Castiatic Tackle» joué au pire strut de garage qui fut - What did she ask ?/ Are we good ?/ Yeah I think - Extrêmement solide et parfaitement cognitif au plan textuel. Il bouclait cet album effarant avec «Mega-Feast», véritable coup d’exacerbation trapézoïdale, et «MT Work», joué à la pure énergie créative. Ce groupe fonctionnait alors comme un geyser galactique.
On trouvait un redoutable écorché sur la pochette du Carrion Crawler/ The Dream EP paru en 2011. C’était encore une fois foutu d’avance, on sentait dès le morceau titre d’ouverture que l’album allait nous emporter la bouche. Il attaquait ça à la dégringolade d’eat meat/ Fill with holes. Il jouait ça avec un pugnacité illicite qui favorisait l’apparition d’hallucinations. En écoutant «Contraception/Soul Desert», John Dwyer établissait en peu plus clairement sa réputation de créatif illimité. Il emmenait son cut ventre à terre, à la petite exacerbation cadencée, the jewel of a song. Avec un tel homme, on se sentait vraiment en sécurité. En fait, il reprenait le «Soul Desert» de Malcolm Mooney, l’un des chanteurs de Can. Mais il pouvait aussi se faire presque passer pour la réincarnation de Picabia et piloter une Delage coiffé d’un bonnet de cuir. On avait aussi un instro cinglant nommé «Chem-Farmer» et en écoutant cette merveille on savait John parfaitement incapable de décevoir les thuriféraires. Zi Oh Sees redoublaient d’une pratique abusive de la liberté à tout crin. Et la dynamique reprenait de plus belle avec un «Opposition» monté sur un beat de pétarade pète-sec et un clair de son qui permettait de distinguer ces deux choses différentes que sont les cartilages du concept et l’élancé d’une démarche d’accompagnement cérébral. Ah mais le pire était à venir, car en B se nichait «The Dream», doté d’une fabuleuse vélocité de team intime. Ces gens-là savaient compulser dans le même sens et se passionner comme des vierges rouges pour mieux embrasser l’univers. Une fois de plus, ils tapaient dans l’essence de Can, à la bonne franquette hypno. Ils retrouvaient ce sens du panache d’effluve mythique et de plumes d’autruche, on sentait battre le pouls d’une machine de mouvement perpétuel, une véritable tinguelynade d’eau fraîche et d’amour de Sainte-Phalle. On tombait plus loin sur un nouveau trésor ali-babique intitulé «Crushed Grass», joué à la cocotte véloce d’under car et de moon beam, très proche du «Locomotive Breath» de Jethro Tull. Ils y rebattaient les cartes d’une belote de belettes. Une fois de plus, on avait dans les pattes un album créativement rempli jusqu’à la gueule, ce qui devient aussi rare qu’un cheveu sur la tête à Mathieu. Ça repartait de plus belle avec «Crack In Your Eye», extraordinaire fragrance d’univers intermédiaire et constamment visité par des idées de rafles riffales, de grattés dauphinois ou encore d’espolettes pimentées. En prime, John Dwyer s’amusait à screamer ici et là, histoire de nous rappeler la fortitude de son émancipation. On retrouvait dans «Heavy Doctor» les accords que joue Robert Quine dans l’intro de «Blank Generation». Il s’amusait à virevolter dans les trapèzes d’un Barnum post-punk et il ah-ahtait sur des descentes de gamme fuligineuses - It’s just a breeze upon a blood-rich sea - Encore un album dont on sortait à quatre pattes.
Une horrible main décrochait un téléphone sur la pochette de Castlemania, un double album qui se jouait en 45 tours. John Dwyer embarquait l’«I Need Seed» au beat pop mod d’I need to throw up the grass. Son beat sautillait dans la prairie, et un vent de liberté soufflait sur le pays. Une fois de plus, il défiait toutes les lois de la physique et ne respectait rien, pas même le vieux principe de gravitation universelle si cher à Newton. Avec «Corprohangist», John Dwyer cherchait un fouet pour se faire battre et traitait sa chanson de tous les noms - Oh yeah this song is sung/ This song is shit - Il sortait la meilleure fuzz de son chapeau de magicien pour un «A Wall A Century» heavy et solidement dérangé, comme ébahi à Tahiti. Il nous faisait le coup de la B qui tue avec une série invraisemblable de smash-cuts, à commencer par un «Spider Cider» joué au prog protubérant, juste pour exprimer ce qu’est le blaze, suivi de «The Whipping Continues», petite heavyness plombée au LSD et relativement pompeuse, au sens de l’Oracle des Zombies de Delphe. Ah, mais il n’allait pas s’arrêter en si bon chemin car voilà qu’arrivait «Blood On The Dock» une pop de pirates, avec un dark ship foating after me, oh no no no et il poussait le bouchon encore plus loin en passant un solo oriental de Mahabarata digne du Barabajagal, ce qui semblait logique vu qu’on retrouvait Donovan dans l’histoire. Il lançait «A Warm Breeze» à coups d’harmo sixties et recréait l’illusion d’une incommensurable diversité des genres, un peu comme si son éventail s’étendait à l’infini, telle l’une de ces japoniaiseries chères à Stéphane Mallarmé qui, souvenez-vous, fut le pape de la rue de Rome.
L’homme à tête de chien qu’on voit dans un cercueil au dos de Putrifiers II EP n’est autre que John Dwyer. Putrifiers II EP fut aussi le dernier album des Oh Sees paru sur In The Red. Il attaquait «Waw Face» à coup d’Oh wite ! Quel dingue, ce mec ! On le voyait tirer son son avec opiniâtreté et comme il visait la mad psychedelia, il créait les conditions d’une sévère lactose pariétale. Ses cris relevaient de l’organique et on sentait un mouvement indicible, pareil à celui d’une armée en marche dans un univers en ordre, une troupe compacte et bien gardée sur ses flancs. Il passait à la pop tétanique, et même très tétanique, avec «Hang A Picture». Cet homme n’en finissait plus de se vouloir complet, il tâtait de tous les genres avec un égal bonheur et dressait une nouvelle typologie du rock, d’une manière qu’il voulait exhaustive, sachant bien que l’exhaustivité ne compte pas dans l’absolu de la relativité. Il revenait à un format plus garage avec un «Flood’s New Light» bien martelé et chanté à l’ersatz de voix. En B, il nous régalait de «Lupine Dominus», une pop joliment enveloppée, montée sur un thème de guitare bien gras qui pouvait à la limite sonner comme une trompette wha-wha, ce qui ne manquait de nous galvaniser.
Avec Floating Coffin et sa pochette sucrée aux fraises, John Dwyer ouvrait l’ère Castle Face, un label aventureux au logo protéiforme. Il donnait le la avec un coup de grisou garage, «I Come From The Mountain», bien cavalé à travers les hautes plaines. Et toujours ces wow ! suivis de plongées en enfer. Comme dans ses autres chansons, il shootait un couplet en boucle d’argent gris - Girls like to smile half the time/ Boys are the trouble all the time - On avait là un vrai hit sauvage. Il en ramenait un autre à la suite, le fameux «Toe Cutter/Thumb Buster», épais et mélodieux, magnifique d’élévation spirituelle. Il le revisitait au thème gras et altérée. On avait là un cut incroyablement beau et paisible et il n’en finissait plus de relancer son équipage. Il revenait à sa vieille passion pour Can avec «No Spell», hypno à gogo ponctué de wow de la Wells Fargo. Et puis il bouclait l’A avec «Strawberries One & Two», une mélasse lysergique à l’étique raréfiée, mais il n’en cherchait pas moins l’espace du promontoire prométhéen, ainsi que des avances sur recettes. Oh et puis en B, il exultait avec «Maze Pancer» - No brains inside of me ha !/ Nothing inside of me ha ! - Il s’esclaffait alors que son char filait à train d’enfer à travers la morne plaine de Mésopotamie. Son attelage étincelait sous le soleil. Il jouait plus loin un «Sweets Helicopter» en mood de mode Pinder sous la voûte étoilée d’un chapiteau, avec des accords voltigeurs et des animaux en peluche.
Avec Drop, John Dwyer inaugurait la série des pochettes ratées, au nom de la liberté, bien sûr. Il attaquait avec un «Penatrating Eye» joué au heavy bulbique, une histoire d’œil volé. On se retrouvait confronté une fois de plus à la réalité d’un mec comme John Dwyer, incapable de se prendre au sérieux. Il chantait ensuite «Encrypted Bounce» d’une voix d’ange de miséricorde, sur un joli beat de rase motte. Il y avait encore là de quoi nous fasciner jusqu’à l’os du genou. Il s’agissait en effet d’un cut monté à l’idée pure, conçu dans un esprit de maniaquerie invétérée, digne d’une vestale vénale. Et en B ? Eh bien, il s’y passait des choses pour le moins intéressantes, comme ce morceau titre amené en forme de garage pop d’I don’t expect to see you again oh yeah, avec de la fuzz plein la bouche. Il enchaînait ça avec un «Camera» chargé de mad desire, celui de porter les visages des autres hommes. Pas facile. S’il fallait s’appesantir sur un cut, ça ne pouvait être que «Transparent World», joué au groove ambigu de fusion saxée sur une belle bassline de Chris Woodhouse.
Un drôle de monstre armé d’un flingue spongieux orne la pochette de Mutilator Defeated At Last. On était tout de suite frappé de plein fouet par l’énorme «Whitered Hand» qu’il joue encore aujourd’hui sur scène, un hit athlétique et complètement fascinant, sur lequel il bondit de droite et de gauche comme un Nijinski devenu apoplectique. Par contre, «Poor Queen» allait plus sur la pop. Il jouait ça aux accords byzantins de cristal d’apothicaire du Carrefour de Buci, d’autant qu’il s’agissait d’une bonne nouvelle - the queen willl live/ To see another day - Il enchaînait avec un «Turned Out The Light» presque glammy dans l’essence, un cut admirable et juteux comme un fruit trop mur. Et puis il bouclait l’A avec «Lupine Ossuary», un instro joué à la virtuosité paganinique. Franchement, ce mec pouvait tout se permettre, comme le montrait encore «Holy Smoke», un hit de B, une sorte de carpaccio d’arpèges frelatés et servi sur une fine couche d’ambre jaune.
L’an passé sont sortis trois albums des Oh Sees, à commencer par l’un des plus beaux albums live de tous les temps, Live In San Francisco. Ça démarre avec l’effarant «I Come From The Mountain» tiré de Floating Coffin, traité ici en violent mode garage californien, joué à la tonne de son et savamment vrillé de solos. Et c’est là qu’on retrouve la powerhouse des deux batteurs, et croyez-moi, ça change tout. Ils enchaînent avec «The Dream» tiré du Carrion Crawler/ The Dream EP. Derrière John Dwyer, ça bat comme chez les Pink Fairies, ça joue à l’extrême clameur d’Elseneur. Ils embarquent «Tunnel Time» au beat de ventre à terre, au pulsatif compulsif. Tim Hellman gratte du bassmatic à flots continus. Heureusement qu’il joue sur Ricken. Ils attaquent la B avec un «Web» tapé au groove anglican et les Oh Sees suent sur «Man In A Suitcase». Oh les Oh Sees savent ! Ils jouent l’organique à l’état le plus pur. Tiens, revoilà l’excellent «Toe Cutter/Thumb Buster» tiré de Floating Coffin et riffé à la Teddy Bear, mais complètement dérangé au plan sonique. John Dwyer barde son art de son et crée les conditions de l’extravagance. Il ramène le souffle d’un Abel Gance dans le rock moderne. Ils attaquent la C avec l’infernal «Withered Hand» tiré de l’album précédent, véritable blast de powerhouse, une branle se met en branle, alors si ça n’est pas du blast, qu’est-ce donc ? Rien de plus déterminant qu’une powerhouse décidée à en découdre. Avec «Gelatinous Cube», John Dwyer claque ses chœurs et profite de la moindre étincelle de frénésie pour sombrer dans le chaos. Il joue la carte des frénétiques de l’Avant siècle. Ils bouclent en D avec un «Contraption» survolté que vient concasser un chorus spatial et aventureux. John Dwyer a mis au point une formule infaillible. On se régale de cette énorme jam entreprenante. On parle de cette face cachée comme on parlerait de l’œuvre de toute une vie.
Pochette à la Chirico pour A Weird Exits paru la même année, mais un Chirico qui irait mal. Ça commence par une belle énormité, «Dead Man’s Gun» tarabusté vite fait et fracassé par un solo signé Dwyer. C’est joué à l’hypno fatidique et Brigid Dawson vient faire des voix de Bogus Man avec cette bête de John. On trouve en fin d’A un «Jammed Entrance», c’est-à-dire un instro tendancieux. On s’y perd en conjectures, tant l’automatisme prévaut. Picabia aurait adoré cette dynamique interne de piston polyglotte à poil dru. On retrouve l’hypno magique des Oh Sees en B avec un «Plastic Plant» chanté à la voix blanche et ils enchaînent avec le faramineux «Gelatinous Cube» qu’on trouve aussi sur l’album live. John Dwyer file en mode garage punk, avec cette façon exclusive de trousser des petits éclats de solos, pendant que la bassline ondule comme le ventre d’Oum Kalsoum sous le satin des draps du Cheik en blanc.
John Dwyer explique que l’album An Odd Entrances paru lui aussi en 2016 est le petit frère du précédent - An appendix, if you will - On s’y régale d’un «The Poem» joué au bel arpeggio de Giotto. Ce sacré John Dwyer semble même se prélasser dans la coquille de Boticelli. On retrouve son appétence pour la pop en B avec «At The End Of The Stairs». On sent chez lui le pape de plage, le ponte du peuple. La pop n’a plus de secret pour cet homme. Et puis on tombe sur une merveille, «Nervous Tech», joué sur un tapis de brousse de basse, très Can dans l’esprit. John Dwyer continue de repousser les frontières du possible. C’est un acharné de l’acharnement, il veut absolument ne rien devoir à personne. Son instro tentaculaire en laissera plus d’un grosjean comme devant. Ah, il faut avoir écouté ça au moins une fois dans sa vie si on veut mourir moins bête, d’autant que ça s’inspire du «Go Ahead John» de Miles Davis. Pas de meilleure source ici bas.
Alors, au point où on en est, on peut aussi aller fureter dans les compiles des Oh Sees, tiens par exemple le volume 3 des Singles Collections. On y trouve des démos, des inédits et des reprises. Quand on sait de quoi est capable John Dwyer, on ne risque rien. On trouve dans ce volume 3 une fantastique démo de «Crushed Grass» montée sur une bassline brontosaurique, une vraie monstruosité lovecraftienne. John y couine comme l’orfraie d’Alfred de Vigny. Ils font aussi une reprise de «Burning Spear», un cut de Sonic Youth, mais John Dwyer l’allume aux lampions de la folie expressionniste, et ça déferle comme des paquets de mer sur nos hures de pauvres ères. Aucun égard pour la mansuétude ! Avec «What You Need», John Dwyer retourne dans la pampa pousser des woo ! et des yooo ! Il adore ça. En B, on tombe sur le processionnaire «Always Flying», sur un «Devil Again» sautillé comme chez les Vibrators et un fantastique «Block Of Ice» live joué au groove profilé sous le boisseau d’argent. C’est une fois de plus l’épitôme du renlentless, l’apologie du jusqu’au-boutisme de Jean Grosjean comme devant, petit neveu du célèbre bagnard échappé de l’île du Diable à la nage.
Signé : Cazengler, pas Oh See mais Ah See (à table)
Thee Oh Sees. Sucks Blood. Castle Face 2007
Thee Oh Sees. The Master’s Bedroom Is Worth Spending A Night In. Tomlab 2008
Thee Oh Sees. Help. In The Red Recordings 2009
Thee Oh Sees. Dog Poison. Captured Tracks 2009
Thee Oh Sees. Warm Slime. In The Red Recordings 2010
Thee Oh Sees. Carrion Crawler/ The Dream EP. In The Red Recordings 2011
Thee Oh Sees. Castlemania. In The Red Recordings 2011
Thee Oh Sees. Putrifiers II EP. In The Red Recordings 2012
Thee Oh Sees. Floating Coffin. Castle Face 2013
Thee Oh Sees. Drop. Castle Face 2014
Thee Oh Sees. Mutilator Defeated At Last. Castle Face 2014
Thee Oh Sees. Live In San Francisco. Castle Face 2016
Thee Oh Sees. A Weird Exits. Castle Face 2016
Thee Oh Sees. An Odd Entrances. Castle Face 2016
Thee Oh Sees. Singles Collection Volume Three. Castle Face 2013
17 / 05 / 2017 – PARIS
NOUVEAU CASINO
T-SHIRT / POGO CAR CRASH CONTROL
Jamais mis les pieds au Nouveau Casino. A l'ancien non plus. Une appellation qui empeste un peu trop l'hypermarché, mais non, pas d' assimilation hâtive et hasardeuse, une véritable salle de concert au plafond capitonné qui doit pouvoir accueillir près de trois cents personnes. Une programmation longue comme un jour sans rock'n'roll, et la file des fans qui attendent devant la porte. Salut à Marie arrivée la première à dix-huit heures trente tapante dans son T-shirt au logo assassin de Pogo Car Crash Control.
T-SHIRT
Personne ne les connaît. Prétendront que c'est leur premier concert – du moins dans un lieu moins exigu que leur appartement - même si l'on retrouve des traces d'antérieures apparitions dans la mémoire inquisitoriale du Net. De toutes les manières on les sent un peu tendus. Mais l'assistance ne sera pas cruelle. C'est qu'ils vont prendre de l'assurance au fil des morceaux et arriver à établir le contact.
Groupe mixte mais sans parité, une fille deux garçons. Difficile de définir le style, les deux premières entrées en matière, Mide and Hyper, flirtent avec le white rock, guitare filante et rapidité du drummin', mais ces caractéristiques vont s'effilocher au fil des morceaux. Léa se cache derrière ses lunettes et le micro de sa voix exigerait que l'on hausse le ton, la guitare surfe mais deviendra de plus en plus affirmée tout le long du set. Première caractéristique, les fins impromptues qui vous laissent sur votre faim. Les morceaux sont aussi courts que leurs titre : Heaven, Dates,Triton, Razor, Cold, Sloan... Serait-ce l'indication d'une allégeance vertueuse à l'esthétique des Ramones ?
Rien de novateur, T-Shirt joue un rock basique sans surprise mais bien balancé, tout compte fait agréable à écouter. Des murmures d'approbation monteront de la foule au fur et à mesure que Toma appuie de plus en plus sur ses toms et que Luc à la basse double la voix de Léa. A moins que je n'aie inverti les deux prénoms. L'est sûr que l'appétit vient en mangeant et notre trio prend du poil de la bête au fur et à mesure qu'il déroule sa set-list. Z'ont encore le problème de l'ampleur du son à résoudre. Faut lui donner une couleur et une tessiture qui deviennent marque de fabrique à part entière, ce qui est sûr c'est qu'un jour ou l'autre nous repasserons sur notre torse velu le même T-Shirt.
Sortent de scène sous les applaudissements ce qui n'était pas donné de la part d'une assistance venue pour les P3C...
POGO CAR CRASH CONTROL
En attendant Pogo... noir absolu parcouru de glauques luminescences... la tension monte de douze crans en moins d'une seconde, de la sono émerge un glas fatidique et irréversible, ce qui s'avance vers vous dans le lent égrenage de cette lourde ponctuation sonore, c'est la statue du Commandeur qui s'en vient demander sa ration d'âmes, les nôtres, tremblantes d'excitation à l'idée que dans quelques secondes débutera le grand transbordement énergétique.
Déchirure. La salle explose. Jusqu'à la fin du set ce ne sera plus qu'un horrible pandémonium de corps agités et entremêlés. Les Pogo ont frappé. Ne sont en rien des adeptes de la montée en puissance. Donnent tout et tout de suite. Sans attendre. Sans pitié. D'abord la voix, ce rut de colère, cette vomissure sanglante, qui défèque du plus profond des entrailles de la révolte métaphysique adolescente, le non définitif jeté en défi à la platitude du monde, le veto bestial s'opposant à la tristesse des existences, la condamnation excrémentielle de nos conditions de survie, tout ce crachat de haine et de rage amalgamé dans le rugissement royal des déglutitions vocales d'Olivier, il n'ouvre pas la bouche, il lâche les fauves dans l'arène néronienne de nos frustrations, et puis le reste, toute la musique que je déteste psalmodie Tante Agathe, ce déluge scansique, cette transe diluvienne, cette boule de foudre et de flamme noire comme la nuit qui détruit tout sur son passage, vous percute, vous traverse, vous éparpille, vous cendrifie, qui ne vous lâche plus, qui sans cesse revient sur vous, s'acharne, vous piétine, vous disperse, vous poudroie et vous rend à la poussière de vos égotistes petitesses.
Une seule consolation dans cette humiliation, c'est qu'ils ne sont pas mieux lotis que vous, ne font pas le show, sont eux-mêmes dans le froid de la tourmente de leur radicalité, le rock en tant qu'ascèse orgiaque, Dionysos à tout instant démembré en un rituel ultime cent fois recommencé. Jouer à perdre haleine, à puisqu'à chaque fois c'est le sort du monde qui est en jeu, que la guitare se désaccorde que le venin s'épaissit en une gangue de matière noire, l'étron fécal alchimique qui se doit d'être transfiguré en le grès rouge de tous les triomphes, Alexandre forçant les rives du Granique, entraînant ses compagnons dans les escarpements du surpassement de soi-même et des autres.
Même Lola. La douce Lola. La frêle blondeur de Lola. Désormais guerrière provocatrice. Ponctue d'un triple coup de poing définitif, les soubassements néandertaliens, ces rafales sismiques de secousses telluriques dont les soubresauts répétitifs parsèment de cataractes géantes le long torrent tumultueux qu'est l'échevellement musical, le scalp trombinoscopique des Pogo. S'avance au bord de la scène, darde ses yeux sur vous, de longs traits de haine qui vous fusillent à bout portant, et puis recule avec ce sourire roué et en même temps naïf qui parcourt le visage des douze princesses des mortifères ballades de Maeterlinck, celles qui vous rongent l'âme, l'air de rien mais plus gloutonnes que le serpent Apophis qui vous attend dans la barque de votre éternité compromise... Petite fille cruelle qui arrache méthodiquement d'un sourire angélique les ailes des abeilles, juste pour leur apprendre à ne pas voler.
Torse nu, d'une pâleur qui n'est pas sans rappeler la terrible bancheur cahalotique de Moby Dick, Louis à la batterie, sabote notre ouïe. L'on n'aperçoit que ses bras sémaphoriques, sémaphoniques, levés très haut – comme des signes d'appel et d'invocation des divinités du mal. Doit bien les rabaisser de temps en temps sur ses toms pour leur faire la peau comme le prouve le roulement continu des huit sabots de Sleipnir le coursier frénétique qui galope et tournoie sans fin dans un ébranlement rythmique infini.
Flash sur la salle. Des corps sont portés à bout de bras comme des victimes expiatoires que dans un enthousiasme délirant l'on emmène en offertoire devant la scène afin qu'elles soient honorés d'un regard approbatif d'Olivier qui n'en continue pas moins de violer sa guitare et d'éructer le chant tribal des hordes fratricides. Certaines sont déversées sans ménagement sur la scène, s'enroulent dans les fils, mouches engluées dans la toile de l'aragne, s'écroulent par terre entraînant avec elles dans leurs efforts reptatifs de délivrance les pieds de micros. Inutile de s'inquiéter, Royaume de la Douleur, Hypofhèse Mort, Paroles M'assassinent, Rire et Pleurs, toute cette folie est inscrite et préfigurée dans les paroles du groupe. Jusqu'à ce quidam qui s'empare du pied du micro, ne le lâche plus et en tape résolument le sol comme s'il voulait écraser les serpents du désespoir de la chevelure vipérine de Méduse qui chaque matin nous sert de miroir. Olivier agonise sur le sol, mais tel le phénix se relèvera et renaîtra à plusieurs reprises de ses flammes auto-combustatoires.
Apocalypse finale, débâcle, carnage, carambolage, Olivier lance les hostilités, prophétise notre futur injonctif, Crève hurle-t-il et la sarabande de la démence s'empare des esprits. Difficile d'en relater un compte-rendu objectif, les deux guitaristes sont dans la salle et Simon se lâche, lui qui avait été particulièrement brutal envers sa guitare durant tout le set, lui qui s'était lancé dans des vocaux astringents comme des tentacules de pieuvre ne se retient plus. Slide sur les cordes avec le cromi, obtient ainsi une espèce de vomi grésilique de crocodile des plus délicieusement alligatoriens. Et c'est fini. Tout s'arrête. Vous savez bien que cela finirait ainsi mais la pierre froide du tombeau s'est refermée sur vous et vous êtes définitivement seul. Tout le monde se regarde, l'on touche un peu son voisin pour savoir s'il est bien vivant. Malaise général. Comment se raccorder à la réalité après une telle effulgence. Une seule échappatoire, un rappel, retournent enfin sur scène, dégoulinants de sueur et d'eau dont ils se sont abondamment aspergés dans les coulisses pour éteindre le feu inextinguible du rock noise qui court encore dans leurs veines. Reviennent épuisés mais le sourire de la victoire aux lèvres. Olivier nous traite d'américains puisque l'on demande more à mort. Et ajoute qu'il est a lonely guy. Toutefois adulé rajouterons-nous. Un dernier Crash Test. Dantesque. Démentiel. Et nous les laissons partir.
Pogo Car Crash Control. Souvenez-vous de ce nom. Ce n'est pas seulement un bon groupe. Ces jeunes gens sont en train de construire une légende.
( Photo : Guendalina Flamini )
Damie Chad.
21 / 05 / 2017 – SAVIGNY-LE-TEMPLE
L'EMPREINTE
SCORES / SEVENTY SEVEN
THE NEW ROSES
Dimanche après-midi, L'Empreinte, Savigny-le-Temple, dix-huit heures, horaire un peu inaccoutumé pour un concert, mais à ne pas manquer, trois groupes, j'ignore tout des deux derniers, mais ce n'est pas pareil pour le premier, The Scores, un concert pas tout-à-fait comme les autres, le groupe a annoncé sa dissolution, deux ans et demi que nous les suivions sur KR'TNT !
SCORES
Sont là tous les quatre, Elie Biratelle à la basse, Léopold Leroy et Simon Biratelle aux guitares, Nicolas Marillot engoncé dans sa batterie, lancés dans une intro tonitruante lorsque de derrière les amplis où il s'était tapi surgit Benjamin Biot-André, s'empare du micro comme d'une hache d'abordage et entame autour de sa hampe une danse scalpique des plus sauvages, les Scores nous livrent le set définitif, seulement sept titres mais sans une once de graisse, sept épures magistrales, parfaites, l'essence d'un rock'n'roll qui flirte avec le hard sans jamais s'appesantir en des clichés par trop appuyés, trois guitares inspirées poussées grand vent par la frappe multiplicatrice de Nicolas, Good Night, Naughty Angel, Leave me Now nous tombent dessus, énergie à l'arrache au service d'une architecture mûrement maîtrisée, trois traînées d'or ruisselantes telle la semençale pluie de Zeus entre les cuisses de Danaé, et puis Ben prend la parole, explique que c'est le dernier set, à l'Empreinte, là où ils avaient débuté, évoque en mots simples ces cinq années d'amitié fraternelle et toutes ces rencontres que l'existence du groupe a générées, phrases émouvantes qui bénéficient de l'attentive compréhension du public qui pour une grande partie les découvre, et qui se demande le pourquoi de cette séparation, alors que le groupe fait preuve d'une cohésion exceptionnelle. L'on sent la salle touchée, mais Scores repart avec Forget About It – il est des moments de sincérité qui ne s'oublient pas, Take a New Turn – titre prophétique – mais le meilleur est à venir, une version de Born To Be Wild d'une justesse bouleversante, les Scores se sont appropriés le morceau, y ont imprimé leur marque, l'ont customisé à leur manière, en ont saisi le balancement particulier créé par cette ligne de basse et ces riffs de guitare qui ont l'air de se marcher dessus, Ben magistral au chant, pas de criaillerie, mais sa voix évoque le moutonnement infini de l'asphalte et ce désir fou de liberté et cette appétence pour le goût sauvage de la vie qui reste une des vertus cardinales du rock'n'roll, public subjugué, longs applaudissements, et puis le plus amer, Hammer of Life, le dernier morceau, la philosophie à coups de marteaux, ce besoin irrépressible proprement humain de casser les plus beaux jouets que l'on a soi-même fabriqués, la musique nous remplit et nous transporte, mais l'impression que plus personne n'écoute, l'assistance stupéfaite, silencieuse, chacun renfermé en soi-même à méditer sur la réalité des songes qui ne collent à vos doigts qu'un bien court moment et puis s'enfuient l'on ne sait pas trop pourquoi, le chef d'oeuvre s'achève, Ben nous remercie, des mots de braise et de feu, évoque la fin d'un cycle qui se termine sans haine et sans tension et d'un autre qui ne manquera pas de s'ouvrir, Scores est arrivé au bout de son sillon, l'oeuvre est accomplie, la boucle est en train de se refermer, et c'est tout, et les applaudissements éclatent, chaleureux, infinis, ils sont sortis depuis longtemps de scène que le crépitement des remerciements continue... Un instant de grâce et de gratitude. Le concert aurait pu s'arrêter là que rien n'aurait manqué, il est des moments d'une telle intensité qu'ils se suffisent à eux-mêmes, merci SCORES pour tout ce que vous avez accompli, et ce set de toute beauté qui sut accrocher un reflet d'éternité.
SEVENTY SEVEN
The show must go on... scène vide, retentit une musique western d'Ennio Morricone, l'on ira jusqu'à la fin du morceau avant que '77 n'investisse le plateau, trois grands gaillards devant – à croire qu'il faut passer sous la toise pour entrer dans le groupe - mais non le quatrième est d'un gabarit bien plus modeste, un freluquet quand on le compare à ses acolytes, Andy Cobo s'installe à la batterie. Etonnant. L'est comme ces boxeurs qui ne connaissent que deux parades, le crochet du droit et le crochet du gauche. Vous refile cent fois de suite le même plan, légèrement de profil, orienté selon sa caisse claire, idem pour le break, la même distribution à chaque fois. Mais, il y a un mais. Cela pourrait être monotone. Pas du tout, vous dégage un train d'enfer, une machine gun inépuisable, une pêche infernale, d'une efficacité exemplaire, un plaisir extraordinaire à le voir jouer, avec sa coupe de cheveux à la P. J. Proby, son allure de gamin, et sa manière de bomber le torse, de lever le poing et d'exhiber fièrement les muscles de ses bras après chaque folle exagération rythmique, il pousse le groupe d'une façon insensée. D'autant plus folle que les trois tueurs de devant n'ont pas besoin qu'on leur donne le mauvais exemple. Arnaud Valeta et LG Valeta sont aux guitares, pas de la valetaille de dernière zone, vieille Gretch écaillée pour Arnaud et Gibson guère en meilleur état pour LG, viennent de Barcelone, sont comme tout Espagnol qui se respecte donnent l'impression d'avoir toujours une paella sur le feu et un taureau à tuer. Un bicho trucidé chasse l'autre vitesse grand V. Vous envoient de ces estocades de riffs à vous transpercer le corps, de l'acier de Tolède trempé, flexible et imparable. A la basse Guillem Martinez ne s'en laisse pas compter. Vous coupe les oreilles et vous hache la queue cent coups férir. A eux trois ils vous tissent un rideau de fer hardique impénétrable, et avec Andy par derrière qui vous bat la sangria à l'agua ardente, vous avez intérêt à vous faire du souci. Ses congénères le laissent tout seul pour un petit ( en stylistique cela s'appelle de l'antiphrase ) solo, nous montre tout ce que l'on subodorait qu'il devait savoir faire, nous expose à loisir, son truc à lui pour dézinguer le zinc des zimballes, l'on dirait qu'il les crisse avec des griffes de chats, vous scratche la crash et vous ride la ride, un gamin instable qui ne peut s'empêcher de taper de-ci de-là, l'on ne sait pas pourquoi, les baguettes en vadrouille, la pédale qui tamponne la grosse caisse, arrêt-buffet, en profite pour gonfler le biscoto de son bras droit à la Popeye voulant impressionner Olive et brusquement c'est la fixette sur el cencerro, je vous sers le terme hispanique, en français ce serait cloche à vache, heureusement d'ailleurs que la bovidette n'est pas là, sinon elle vous prendrait une de ces dégelées à mériter l'urgente intervention de la SPA, bref la cowbell il vous la fait meugler à faire trembler les loups les plus féroces de peur dans les alpages, l'anarchie totale et une miraculeuse architecture, de quoi flanquer une jaunisse sidérante ( et une leçon d'harmonie transgressive ) à tous les timbaliers du London Symphonic Orchestra, en tout cas l'assistance applaudit à tout rompre, tandis que ses compagnons reviennent opérer une dernière razzia de guitares sans retard. Quittent la scène sous les acclamations. Seventy Seven, pure jouissance rock'n'roll.
THE NEW ROSES
Faudra quatre morceaux pour entrer dans les corolles carnivores des Nouvelles Roses. Après la tornade des Seventies, la tâche me paraissait quasi-impossible. Mais vont y réussir complètement. Efficacité allemande. Vitesse et confort. En douce, vous enveloppent l'air de rien, s'entendent comme des larrons en foire de Berlin, normal viennent d'outre-Rhin, vous enfonce dans la meilleure ouate astringente que vous trouverez sur le marché. Hardy est aux drums et Urban Berg à la basse, vous filent le chewing-gum de base, malléable à volonté et d'une élasticité à toute épreuve, refuse de se désintégrer, de se réduire à quelques filaments filandreux qui vous prennent les amygdales au lasso, une section rythmique de rêve sur laquelle vous pouvez tout vous permettre. Cela tombe bien car les deux ostrogoths restants profitent largement de l'aubaine, Norman Bites et sa Gibson en V, vous la manie comme vous un pique-date pour attraper les olives lors de l'apéritif, une dextérité, une habileté confondante, l'en fait ce qu'il veut et il lui demande le maximum, déjà de sonner juste durant qu'il joue, les esprits chagrins avanceront que c'est la moindre des choses, absolument d'accord mais Norman n'est pas homme à perdre le nord, profite du fait qu'il soit sur scène pour parfaire son parcours santé, déambule comme un dératé de long en large, exercices d'assouplissements divers, enchaînement de vertigineuses postures dignes de l'atha yoga, s'arque-boute le dos en arrière à s'en faire péter la moelle épinière, saute, bondit, s'enveloppe la tête de ses longs cheveux, un mélange détonnant de narcissisme et d'attention aux autres, immobilise ses doigts en plein milieu d'un solo pour que le photographe puisse réussir son cliché, surveille attentivement du coin de l'oeil les trois gaminos tout devant leur scène, leur sourit, leur serre la main, leur refile ses médiators, entre temps il joue, et plutôt mieux que bien, à peine touche-t-il ses cordes que cela s'entend, de la haute précision, vous envoie de ces riffs à l'indolence de panthère, à la royal tiger, tachetés à la léopard, l'est chamanisé, habité de l'aisance majestueuse des félins... Timon Rough est au centre, le grand sorcier c'est lui, guitare d'appoint et de pointe, accompagnement et notes qui vous transpercent et vous déchirent, mais au bout d'un moment vous n'y prenez plus garde, vous envoûte de sa voix, épine acérée et suavité des roses, légèrement éraillée, style expérience du baroudeur à qui on ne la fait pas qui a tout connu et tout vécu, la module savamment, l'en profite pour vous engranger dans ballades envoûtantes, les guitares pleurent et votre coeur saigne, vous hypnotise, vous emmène où il veut, commence tout doux mais très vite la machine s'emballe et ça prend une ampleur majestueuse, technicolor et coucher de soleil, le vent courbe les épis de blé, subitement la tempête déboule et déracine les arbres, et enfin un soleil mélancolique baigne le paysage, mais inutile de recourir au suicide il existe des remèdes à tout explique-t-il, une fille perdue et dix dives bouteilles de whisky retrouvées, ivresse joyeuse, et voici un boogie d'enfer qui vous déboule dessus pour vous entraîner dans une course folle... Reviendront pour un rappel de quatre morceaux, deux trip ballades à vous faire gémir sur les morts de Roncevaux et deux hard songs qu'ils ont dû mal à terminer, remettant à chaque fois que le moteur s'arrête de la gazoline dans le réservoir et c'est reparti pour un tour de piste à fond de train, sortent sous les acclamations du public dont une grosse partie est manifestement composé de fans avertis.
BEAUTIFUL FRIENDS
Les Scores sont dans le hall, possèdent et vibrent de l'indéfectible beauté de la vingtaine, viennent d'offrir et de partager le reliquat de leurs deux disques et de leurs t-shirts, sont maintenant maintenant réunis en cercle – ring of fire - restent soudés entre eux, même s'ils se séparent, chacun ira son chemin, encore incertain, mais mille pistes d'intensité inexplorées les attendent. Rock'n'roll can never die !
Damie Chad.
CONSEIL / CLIP
POGO CAR CRASH CONTROL
TEASER
Savent faire monter la sauce les Pogo d'abord un teaser pour annoncer la parution immédiate du Clip. Tête totémique de mort sanglante qui se décharne vitesse grand V jusqu'au squelette final en neuf secondes. Plus la mâchoire inférieure qui rigole. Bientôt un nouveau clip en lettres rouges s'inscrit sur l'écran. Grand guignol pré-néolithique. Esthétique sauvage écriront plus tard les ethnologues.
CONSEIL
Hall blancheur aseptisée d'hôpital. Psychiatrique. Inutile de préciser, vous vous en doutiez. Nouvelle méthode, thérapeutique douce, on laisse les pensionnaires vaquer à leurs occupations habituelles. Afin de ne pas provoquer le stress supplémentaire que ne manque pas d'induire une coupure par trop brutale avec les comportements existentiels antérieurs à l'enfermement. Me permettrai pas de condamner cette cure médicale d'un genre nouveau, me contenterai d'en juger sur pièce au vu des résultats. Que nous devons avouer déplorables.
Certes l'on a remplacé la bonne vieille camisole de force par un t-shirt d'un blanc immaculé et d'un futal noir ébène, et on leur a refilé leurs instruments. Les pauvres, par un réflexe pavlonien du pire effet se sont précipités dessus et se sont lancés dans une répétition, peut-être même se croient-ils en leur cerveau dévasté en plein concert. Le document que nous communique si aimablement le docteur Romain Perno est des plus intéressants. Réalisé avec un scanner des plus révolutionnaires. Le principe en est simple. Au lieu de vous refiler des coupes gélatineuses de synapses en pleine action, totalement incompréhensibles pour tout individu dépourvu d'un diplôme d'ingénierie scanique, la bécane traduit l'activité mentale des neurones en les donnant à lire comme ces réactions émotionnelles qui affectent votre visage lorsque vous recevez un courrier de votre percepteur vous réclamant cinq ans d'arriéré-d'impôts.
Terrible et effarant spectacle. La caméra se fige sur le visages de nos P3C, les images se bousculent et se coagulent, un cauchemar épileptique, les plans se succèdent et s'entremêlent, ruptures schizophréniques et fractures paranoïaques se chevauchent, rien de stable, tsunami de rictus démoniaques, éclats du miroir de l'âme fragmentée, brisée, éparpillée, tous atteints, irrémédiablement, accrochez-vous c'est la réalité du monde qui se fragmente, je n'ai jamais vu ça grommelle le docteur Perno, et j'ai bien peur que ce ne soit transmissible, une espèce de virus mental qui affecte ceux qui se trouveront pris dans les rayons de leurs yeux globuleux d'un bleu si pur, une catastrophe, je crains de rester dans la mémoire de l'humanité comme l'inventeur du bacille de Perno, le plus répugnant qui soit, vous rendez-vous compte cher Damie, encore quelques mois de recherche et j'aurai isolé le microbe de la folie. Une espèce de fibrome méningé dont la propagation se révèlera cent mille fois plus dangereux que le virus du sida. Je prévois une pandémie qui risque d'éradiquer l'espèce humaine de la planète.
Je me hâte de répondre : certes cher Doctor Perno, c'est parti pour un sale pastis mais il y a tout de même un bon côté à ce phénomène, ce qui est mauvais pour l'humanité est visiblement et auditivement très bon pour le rock'n'roll ! Evidemment rétorque-t-il, si vous le prenez ainsi, mais restons sérieux, je vous en conjure interdisez-vous de révéler à vos lecteurs l'existence de cette vidéo. Vous risquez de déclencher l'apocalypse cérébrale générale. Je me demande même si je ne devrais pas vous interner sur l'heure. Quatre armoires d'infirmiers s'approchent de moi matraque plombée en main, je hurle, ne me touchez pas bande de brutes, mais il est déjà trop tard... Effet rédhibitoire soupire tristement le Doctor Perno.
Damie Chad.
THE HOWLIN' JAWS
COMIN' HOME / I'M HOWLIN'
DJIVAN ABKARIAN : double basse – vocal / BAPTISTE LEON : Drums / LUCAS HUMBERT : guitar
Comin'Home : la voix devant comme jamais sur un enregistrement des Jaws, derrière big mama et la guitare de Lucas sonnent le tocsin, mauvais augure qui se concrétise très vite, Djivan plus pressant que jamais, la batterie de Baptiste qui s'effondre en une dégringolade de fin de monde, Lucas qui finit la catastrophe d'un solo au couteau de commando et Djivan qui vous jette le vitriol de son vocal à la figure, tout cela pour fêter son retour. Vous n'en espériez pas tant ! I'm howlin' : lycanthropie aigüe. Djivan vous susurre un hululement à la douceur d'autant plus inquiétante, et les deux autres loups-cerviers enfuis tout droit du poème d'Alfred de Vigny, vous mijotent un de ces accompagnements de brindille foulée dans le piétinement de pattes peu bruiteuses, le genre de menace insidieuse qui ne saurait durer, vous tombe tous les trois sur un paisible troupeaux de brebis que tour à tour, basse, guitare, batterie entreprennent d'égorger méthodiquement. Le sang frais leur refile une fièvre pulsative, et Djivan clame son contentement à tous les échos. Le désir de chair fraîche n'attend pas. Un morceau à écouter comme la face obscure du petit chaperon rouge.
Les Howlin' deviennent les serial killers du single. Troisième de la série. Les chasseurs de trésor sont sur les dents. Ces trois petits rectangles colorés risquent de devenir des pièces de collection extrêmement prisées par tous ceux qui ont la désagréable manie d'arriver après les batailles ou que leur maman auront éjectés de leurs ventres bien après le déroulement de l'aventure. Quand on pense à tous ces millions d'imbéciles qui n'étaient pas nés alors que l'on construisait les Pyramides ! Tout y est. Z'ont tout compris. Pochettes esthétiques et morceaux d'une imparable efficacité, développent un style et un son qui n'appartiennent qu'à eux. Un des groupes français actuels les plus essentiels. Alors qu'il y a plein de britanic guys qui ne font pas preuve d'autant de pertinence imaginative et refondatrice...
Damie Chad.
AUSTIN OSMAN SPARE
OEUVRES / Tome I
Trad : PHILIPPE PISSIER
( Collection ANIMA / Mars 2017 )
Je vous chronique ce bouquin, je vous sauve la vie. Ne me remerciez pas, envoyez-moi plutôt un chèque. Prochain dîner en ville, coup de Trafalgar, vous vous retrouvez assis en face de Jimmy Page, vous vous sentez mal, que lui dire qu'il ne sache déjà ? Page ce n'est pas la petite voisine du troisième qui ouvre des yeux émerveillés lorsque vous lui montrez votre collection de pirates de Led Zeppe. Ce n'est pas à lui que question rock vous allez lui en remontrer. Il existe bien une sortie de secours. Mais elle est fermée à clef, barricadée de l'intérieur avec des blocs de béton de dix tonnes. Jardin secret de Monsieur Page. Depuis des années, les journaleux n'osent plus évoquer le sujet. Secret défense, à la moindre ombre d'un semblant de fausse allusion Page devient muet comme une tombe. Son visage se ferme, une ange aux ailes cassées passe... ( voir le logo de Swan Song Records ). Ce bouquin est le cheval de Troie qui va vous permettre de pénétrer dans la citadelle. Attention, une fois que vous serez dans la forteresse, faudra assurer, avec ce diable de Page, c'est le grand jeu qui commence. C'est que dans sa vie Page ne s'intéresse qu'à deux choses : la réédition des oeuvres complètes de Led Zeppelin, et Aleister Crowley. La Grande Bête de l'Apocalypse, the king of the road 666, voici votre angle d'attaque, plein feu sur le maître du Dirigeable, Austin Osman Spare est l'anti-Crowley par excellence. Maintenant que vous avez déclaré la guerre, je ne vous laisse pas tomber, vous fournis quelques biscuits, la discussion risque d'être animée.
Austin et Aleister se sont connus, de près. Se sont fâchés aussi. Spare ne pouvait supporter cette grande folle de Crowley. Trop de clinquant, trop de baratin, grotesque et irritant. Le cérémonial, les rituels alambiqués, les formules magicques secrètes révélées par une mystérieuse entité de l'outre-monde, Spare n'en avait rien à faire. Charlatanisme. Lui aussi pratiquait la Magie. Selon un autre mode.
Voici donc le premier volume de ses oeuvres. Vincent Capes et Philippe Pissier ont rajouté aux quatre livres écrits et dessiné par Spare, une introduction d'Alan Moore, et un essai de Julian Moguillansky, manière de vous éviter de perdre pied à la troisième page... Spare naquit en 1886, très tôt il se fait remarquer par ses dessins qui rivalisent avec ceux de Aubrey Beardsley. Une carrière d'artiste reconnu s'ouvre devant lui, mais peu à peu il s'en détournera et finira par y renoncer. Une tâche bien plus étrange l'accapare...
L'est de ces hommes qui cherchent au-delà du vernis de la réussite sociale à réaliser leur moi profond, afin d'en éprouver les modalités les plus opératives. Il ne s'agit pas de faire quelque chose ( de bien ou de mal ) de sa vie, le dernier imbécile venu y parvient sans difficulté, mais d'acquérir une intime compréhension de la réalité afin de pouvoir l'acter selon sa volonté.
Le lecteur ne sera pas sans penser au concept de volonté de puissance de Nietzsche, mais le travail d'un Spare est davantage redevable de la tradition ésotérique que de la philosophie occidentale proprement dite. D'où l'emploi d'un vocabulaire qui n'est pas spécifiquement défini. A la place de concepts il use de vocables utilisés en tant que points de fixation et de globalisation sémantique, le mot envisagé en sa puissance poétique imaginale, ce qui laisse évidemment libre-cours à maintes indéterminations.
Le vecteur de base sparien est le Moi. Rien à voir avec l'égo ou le cogito. Simplement mon appréhension du monde. Premier piège à éviter : ne pas penser que vous détenez la vérité. Si vous trouvez que le paysage est beau, n'oubliez pas que quelqu'un d'autre le trouvera laid. Pire, même si tout le monde se pâme, la possibilité qu'il soit empreint de laideur n'en demeure pas moins. Ni beau, ni laid. Ni-Ni exclut le nihilisme tout comme moins par moins induit la positivité mathématique. Ni-Ni signifie les deux à la fois, en le sens que toute présence objectale s'inscrit dans la dualité de sa non-existence. Deuxième piège à éviter : ne pas céder au doute. Choisissez. Assumez, en toute connaissance de cause. Remarquez en passant que la non-existence de Dieu n'est guère plus importante que l'absence causale aristotélicienne... Bizarrement nous sommes sur une route qui n'est pas sans parallèle avec la démarche kantienne !
Maintenant que vous avez réduit le champ des possibles de l'univers à la non-existence de sa possibilité impossible, il vous reste à agir dans cette espèce de zone de haute neutralité qu'est la réalité. Austin Osman Spare possède sa méthode : les sigils. Les sceaux. S'agit de se fabriquer un signe qui vous permette d'oeuvrer au sens quasi-alchimique de ce terme. Ne vous trompez pas, la réalité extérieure n'offre guère d'intérêt. Elle n'est qu'une interprétation infinie. Ma représentation selon Schopenhauer. L'autre versant de votre volonté élective. Les strates du monde sont à l'intérieur de vous. Freud appellera cela l'inconscient. Mais ne l'imaginez pas comme la poubelle de vos interdits et de vos peurs de laquelle vous ne pouvez de temps en temps vous empêcher de soulever le couvercle. Non, considérez plutôt le gouffre abject de vos immondices phantasmatiques en tant que matrice des temps perdus – qui sont donc aussi conservés – je vous laisse à vos explorations archéologiques. C'est ainsi dans ce mémoriel terreau temporel que l'induction magique de la subjectivité s'objectivise.
Les sceaux sont comme des symboles, des signes simplifiés à l'extrême que vous griffonnez à tâtons sur un morceau de papier dans le but de les mentaliser facilement. Les tenir toujours en représentation dans votre esprit durant votre vie quotidienne. Vous serviront au moment idoine, un peu à l'instar de ce couteau suisse que vous trimballez depuis deux ans dans votre poche mais qui à l'instant précis et critique se révèle l'outil idéal qui vous permet de vous tirer d'une situation difficile... Les quatre espèces de runes zodiacales qui ornent la pochette du Zeppelin IV ne seraient-ils pas des sceaux spariens ?... Profitez-en pour accuser Page de haute trahison. Autre piste de recherche : cette mode des monogrammes dans les milieux artistiques à la fin du dix-neuvième siècle desquels les doctes chercheurs universitaires ne se sont jamais enquis... Et pourtant que de réflexions à mener lorsque l'on considère l'analogie graphique de l'entrelacement serpentaire mallarméen avec la constellation finale du Coup de Dés...
Spare s'est aussi intéressé à la technique du dessin inconscient. Dessiner sans réfléchir, pour ensuite réfléchir à ce que vous avez dessiné. L'écriture automatique des surréalistes n'est pas loin, mais les buts poursuivis ne sont pas les mêmes. Le surréalisme c'est encore le Connais-toi toi-même de la sentence inscrite sur le fronton du temple de Delphes, Spare c'est la deuxième partie de la devise, celle qui établit la nature des Dieux... Le livre présente de nombreux dessins de ce type. Qui ne sont pas très esthétiques, du moins à mon goût, mais ce n'est pas la recherche de cette qualité qui a présidé à leur élaboration, à leur menstruation psychique. En ajout des travaux graphiques de l'artiste, notamment des projets d'Ex-Libris, ces petits rectangles de papier, autant marque d'appropriation hommagiale qu'exaltation hiéroglyphique de soi-même que les bibliophiles se faisaient un devoir de coller sur les pages de garde de leurs exemplaires, tradition qui s'est quelque peu perdue mais qui d'après moi survit étrangement dans ces flyers que les groupes de rock distribuent pour annoncer leurs concerts... Quand on aura rajouté que le sexe semble être pour Austin Osman Spare un moyen initiatique et destructeur des plus essentiels, le lecteur se retrouve en pays de connaissance. Notons que Spare emploie souvent le mot femme quand il veut signifier sexe... Soyez déductifs.
Les recherches de Spare sont relatives, pour ne pas dire absolument relatives – à l'obtention d'une vie de plaisir. Il ne s'agit pas de copuler à outrance. Mais c'est ici que nous voyons s'inscrire en filigrane une des faiblesses de la pensée ésotérique. Celle-ci est fortement marquée par la culture chrétienne qui a accompagné sa naissance et son déploiement. Bien entendu elle possède aussi ses racines païennes, mais elle s'est avant tout pour ce qui nous concerne développée en des siècles éminemment christianophiles. Si bien que Spare et Crowley nés et élevés dans l'Angleterre protestante ont érigé leurs oeuvres impénitentes à l'encontre du puritanisme anglo-saxon. Mais culturellement imprégnés d'un substrat biblique ils ont tenté de pervertir ce legs nauséabond de l'intérieur. Leur vision de la sexualité n'est pas libératoire telle que notre modernité la conçoit, ils effectuent un travail de sape en la présentant comme un retour aux temps édéniques. Perfection de la nudité éveillante d'Eve. Effraction des portes originelles. Au siècle précédent, Les Chants d'Innocence et d'Expérience de William Blake s'aventuraient déjà en de telles et semblables extrémités. Spare est vraisemblablement plus près de Blake que Crowley attiré par l'exemple communautaire de l'abbaye de Thélème. Le fait que Blake et Spare aient été avant tout des artistes – alors que Crowley s'inscrit par devers ses qualités intrinsèques d'homme de lettres et de poète dans le registre des grands communicants – explique la filiation en quelque sorte naturelle entre Spare et Blake qui illustrait ses propres textes.
Austin Osman Spare finit sa vie dans un relatif anonymat. Entouré de ses chats dans le Londres populaire. L'homme s'effaça de lui-même. En notre pays, son nom a disparu de la mémoire collective. Il n'en est pas de même en Angleterre où il ne fut jamais entièrement oublié et où son oeuvre graphique et sa trajectoire individuelle fascinent de nouvelles générations. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des générateurs de la Magie du Kaos... Pour les lecteurs sceptiques quant au sérieux des élucubrations de type sparien et crowleyen, emplis de doute cartésien, nous conseillerons de lire Vision de Yeats, ils ne trouveront pas meilleure introduction, issue du répertoire estampillé « Littérature sérieuse, grand écrivain », à ce type de démarche intellectuelle des plus borderline. Si le Christ a marché sur l'eau pourquoi l'homme s'interdirait-il de s'aventurer au-dessus de l'abîme !
Les esprits curieux ne manqueront pas de se procurer ce premier volume, grand format, papier Bouffant, impression exemplaire, couverture d'un orange philosophal rehaussé d'une titulature d'un jaune aussi dorée qu'une aube, 290 pages, pour la modique somme de 23 euros. Pas cher. Mais le chiffre de l'Eris. Certains comprendront. Mais un lecteur averti en vaut deux.
En tout cas, Jimmy Page connaît tout cela.
Damie Chad.
P. S. : lire aussi notre chronique sur Magick d'Aleister Crowley in KR'TNT ! 162 du 07 / 11 / 2013. Vous y retrouverez en ses oeuvres les plus figuratives Philippe Pissier qui s'impose de plus en plus comme l'un des activistes ésotéristes les plus germinatifs de notre temps. Une figure essentielle à découvrir.
13:10 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : t-shirt, pogo car crash control, scores, seventy seven, new roses, romain perno, howlin' jaws, austin osman spare, thee oh sees
01/02/2017
KR'TNT ! ¤ 314 : KIM SALMON / DÄTCHA MANDALA / POGO CAR CRASH CONTROL / JAMES LEG / ELVIS PRESLEY
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 314
A ROCKLIT PRODUCTION
02 / 02 / 2017
|
KIM SALMON / DÄTCHA MANDALA / POGO CAR CRASH CONTROL / JAMES LEG / ELVIS PRESLEY |
Kim est Salmon bon

Et même pire que Salmon bon. Kim Salmon a du génie. Quand on le voit sur scène, on comprend qu’il est né pour ça, pour jouer du rock sur scène, même s’il se retrouve après trente ans de pérégrinations sur la petite scène d’un bar de Ménilmontant.

Visiblement, c’est à la Féline que se termine la carrière des cult-stars de l’underground, mais l’ambiance y est si bonne qu’on s’en félicite. Ça se transforme même en concert de rêve. La bière y est fraîche, le public conquis d’avance et Kim Salmon joue à cinquante centimètres, alors que peut-on espérer de mieux ? Il joue en trio et Dimi Dero bat le beurre. Il porte une chemise à fleurs, un jean et des boots rouges. Comme Kim cumule les expériences, il dispose désormais d’un répertoire très riche. Trop riche, pourrait-on dire. Il peut taper dans les albums des Scientists, dans ceux des Beasts of Bourbon, dans ceux des Surrealists, dans ses albums solos et dans ses projets parallèles et monter une set-list de rêve, ce qu’il fait.

On entend des hits fatidiques comme «Swampland», inévitablement, mais aussi un «Cool Fire» tiré du fantastique troisième album des Beasts, «Black Milk», «Frantic Romantic» qui date des origines et puis bien sûr les deux énormités tirées de son dernier album solo, «My Script» : «Destination Heartbreak» et l’implacable «Already Turned Out Burned Out». Et puis histoire d’enfoncer le clou pour de bon, il termine avec une version définitive de «We Had Love», une sorte de classique garage capable de nous hanter jusqu’à la fin des temps.

Les Scientists firent partie de la petite scène culte underground des années 80, avec le Gun Club, les Spacemen 3, les Cramps et les Mary Chain. Rien qu’avec ces cinq groupes, on avait de quoi tenir pendant la décennie maudite.

Leur premier album sobrement intitulé The Scientists parut en 1981. On l’appelle aussi the pink album. Sous sa pochette rose et particulièrement insignifiante, l’album sonnait très power-pop et on surprenait Kim en flagrant délit d’imitation de Joe Strummer sur le premier cut, «Shadows Of The Night». Il fallait attendre la face B pour trouver un peu de viande, notamment dans «Teenage Dreamer» qui semblait traversé par le petit riff de «Death Party» mais en accéléré. C’était une coïncidence amusante, on retrouvait l’esprit de ce groove mortel, avec de longs passages ombrageux et des vents de broussailles. Dans «Walk The Plank», ils se prenaient pour les Jam, un mimétisme de mauvais aloi. Et ils s’enfonçaient toujours plus dans l’erreur avec «Larry», ce qu’on appelait alors du fake english sound. Ils sauvaient l’honneur avec le dernier cut, «It’ll Never Happen Again», poppy comme ce n’était pas permis, mais le groupe montrait une assurance exceptionnelle et nous sortait le meilleur des sons.

Sur la pochette du second (mini)album Blood Red River, les cheveux des Scientists avaient poussé. C’est avec cet album qu’ils trouvèrent leur véritable identité. Ils proposaient en effet un son basé sur le groove primitif, celui de l’anaconda géant qui rampe dans la moiteur de la forêt tropicale. L’un de leurs hits les plus viscéraux s’appelle «The Spin». Kim y plonge dans l’épaisseur du groove. Il y pique de sacrées crises et on y retrouve aussi le fameux riff de «Dirt». Comme la plupart des grands hits scientifiques, celui-ci est monté sur une bassline troglodyte. Visiblement, Kim est obsédé par Funhouse. Une autre stoogerie de haut rang se niche sur l’album : «Set It On Fire», chanté à l’insidieuse rampante, et même hurlé dans le néant du non-retour. C’est vrai que la composition de la photo de pochette rappelle celle du premier album des Stooges et Brett Rixton qui est au fond ressemble à Dave Alexander. C’est Tony Thewlis qui allume ce cut et les Scientists le jouent à l’admirabilité des choses. Le morceau titre sonne comme du boogaloo désespéré et sur «Rev Head», Kim sonne exactement comme Alan Vega. Par chance, cet album fut réédité en l’an 2000 par Citadel, le label australien qui eut l’intelligence de rajouter les cuts de singles qui ne figurent pas sur les albums, à commencer par le hit le plus connu des Scientists, «Swampland», une merveille de western-song gothique inspirée. On trouve aussi l’effarant «We Had Love», dévastateur et bousculé par de violentes montées de fièvre, le cut que Kim choisit aujourd’hui sur scène pour boucler son set en beauté. Et puis cette version fantastique du «Clear Spot» de Captain Beefheart. Kim n’a pas la voix, c’est sûr, il lui manque le fond de cuve, mais le son est au rendez-vous. Tony sait faire son Zoot Horn Rollo, pas de problème. On trouve aussi à la suite «Solid Gold Hell», certainement le plus brillant hit scientifique, un chef-d’œuvre de heavyness déviante et la basse de Boris fait le show car elle traverse le cut en crabe. Fascinant ! Autre merveille : «Demolition Derby», un vrai cut-bulldozer qui dégage tout, les avenues et les bronches. Une vraie mastication de riff et comme par hasard, on pense au «Death Party» du Gun Club.

En plus de Blood Red River 1982 - 1984 Citadel a aussi fait paraître The Human Jukebox 1984-1986, la réédition de l’album augmentée de cuts de singles. Ces deux disques valent l’investissement, car dans les livrets, Kim Salmon raconte toute l’histoire des Scientists à Perth, à Sidney, puis à Londres, où ils se firent connaître grâce au soutien de Lindsay Hutton. C’est assez passionnant, car Kim raconte une multitude d’anecdotes, comme celle-ci, qui se déroulait à Amsterdam, devant un club où devaient jouer les Scientists : des mecs les traitaient de kangourous, alors Kim raconte que ça s’est terminé en bagarre.

L’année d’après sort un autre mini-LP, This Heart Doesn’t Run On Blood, This Heart Doesn’t Run On Love. C’est une manie, mais en fait une bonne manie. Pour au moins deux raisons, l’énorme «Solid Gold Hell» qu’on en finit plus de réécouter à cause de cette bassline qui traverse le cut en crabe - Getting really used to live in solid gold hell - et «This Life Of Yours», atmosphérique et underground en diable, comme bardé de toiles d’araignées. On les sent partis une fois de plus à la dérive, la basse de Boris remonte dans le mix de manière seigneuriale et Kim se met à chanter comme Jeffrey Lee Pierce.
Selon Robyn Gibson de Sounds, les Scientists étaient parfaits : long greasy hair, low slung pants, ugly feedback, two chords songs over one note basslines, malovelant countenance.
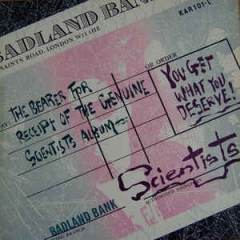
Deux énormités trônent sur You Get What You Deserve : «Hell Beach», une pure stoogerie - Kim chante comme Iggy, avec l’instance nasale des bas-fonds motorcityques - et «Demolition Derby monté sur le riff de «Death Party» ralenti et bien régurgité. C’est tout l’intérêt du cut : le goove de Death, ils ne s’embêtent pas, ils tapent là dans l’un des meilleurs grooves de l’univers et voilà, le tour est joué. En B on trouve «Atom Bomb Baby», accompagné par un gimmick frelon et chanté à la stoogerie des profondeurs de l’underground ténébreux. Kim attaque «Lead Foot» à la Jeffrey Lee, à l’insolence gun-clubbique. On note aussi la présence de l’excellent «It Came Out Of The Sky», garage harcelé par Tony Thewlis sous la pure dominance sulfrique du son de basse.
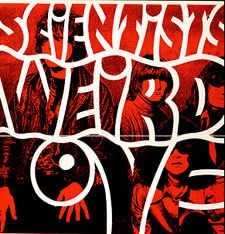
En 1986, ils ré-enregistrent tous leurs hits : c’est le fameux album Weird Love. Quel festin ! Ce sont des cuts dont on ne se lasse pas, allez hop, ils reprennent «Swampland» avec l’ in my heart bien timbré, le stoogy «Hell Beach» bien primitif et même ashetonien, «Demolition Derby - fuelled with a love song gone wrong, comme le dit si élégamment Kim - et «We had Love», le hit du cru. Non seulement le chant y est insistant, mais le riff l’y est encore davantage, alors ça devient rudement intéressant. En B, ils tapent dans «Of It’s The Last Thing I Do» et dans les commentaires, Kim cite le nom de Travis Bickle. C’est joué à l’épaisseur scientifique et visité par l’admirable groove de basse de Boris. Big atmospherix avec «Set It On Fire». On retrouve dans ce cut tout ce qui va faire la force des Chrome Cranks et de Gallon Drunk, le sens du groove souterrain et inspiré. Ils bouclent cet album magique avec une version faramineuse de «You Only Live Twice» qu’ils traînent à la mauvaise vitesse. Quelles brutes ! Le gluant qui suinte de l’ambiance leur va comme un gant.

Ils ne sont plus que trois pour Human Jukebox, Tony Thewlis, Kim à la basse et un batteur du nom de Nick Combe. Spontaneous sonic outburst and desconstruction : voilà comment Kim définit cet album déroutant. Le morceau titre qui ouvre le bal nous plonge tout de suite dans l’ambiance scientifique : dégelée de son et gros coups de jus. Ils avaient compris que tout reposait sur le son et qu’on pouvait aller très loin dans l’explosion des limites. Dans la fournaise on croit parfois distinguer des bouts de Velvet. C’est en effet la dynamique de «Sister Ray» mais avec des queues de phrases grillées au 220 et donc racornies. «Distorsion» sonne comme un cut privé d’espoir, trop épais, lymphatique, comme largué au large, dans une drôle de dérive. C’est hallucinant de liquidité, une sorte de fin du monde de distorse molle. Encore un exploit vicelard avec «Born Dead», claqué à l’accord violent et incroyablement incisif. Kim chante sale et Tony gratte acéré. Leur riff insistant révèle une dimension bornée, peut-être même un manque d’idées, tout au moins pour cet album. Ils finissent avec un mélopif hors du temps, «It Must Be Nice» - It must be nice to die at night - Lourd de sens et de présence et chanté à la mélodie. On a là le hit du disk. Kim résume bien l’art des Scientists : fuzz-guitar overload minimalism and primal beat.
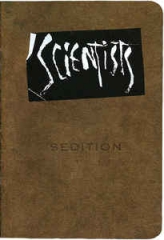
L’album idéal des Scientists est probablement Sedition, paru en 2007 et enregistré live au Shepherd Bush Empire. On y retrouve la formation originale, Kim, Boris et Tony, avec Leanne Cowie, qui avait flingué une tournée anglaise dans les années 80 parce qu’elle ne savait pas jouer de la batterie (elle apprenait). Dans le petit livret qui accompagne le disque, on peut lire des hommages de Jon Spencer, Warren Ellis et Henry Rollins. Les Scientists jouent tous leurs hits, à commencer par l’infernal «Swampland», bien doté à la mélodie. Kim sait monter un coup. Il sait hanter - In my heart, there’s a place called swampland - Il chante ça à l’épique de la désespérance, comme Jeffrey Lee Pierce. En écoutant «Burnout», on voit bien qu’il tient son chaos en laisse. Il ne lui laisse pas de mou. Il jette des pelletées dans le brasier. Tout est très incandescent chez les Scientists. Et voilà l’effarant «Solid Gold hell», attaqué à la fuzz, et la mélodie descend en diagonale à travers le mur riffique. Kim se lamente à la body of soul. Il s’adosse au meilleur wall of sound du monde et Boris envoie ses notes d’infrabasse perforer le chaos. Avec «Nitro», ils rendent hommage aux Stooges. Cette mélasse vaut bien «Funhouse». Kim crie. Kim couine. Kim cuit. Et avec «Set It On Fire», on retombe dans la fournaise scientifique. Kim compte parmi les héros les plus fulgurants de l’histoire du rock, soyez-en sûr. Il pousse des waouh d’antho à Toto et surnage à la surface d’une extraordinaire mélasse de son avec un fabuleux shouting de soute. Bel hommage à Alan Vega avec «Rev Head». Kim fait le talking show et navigue dans le groove urbain. Il peut screamer his head off. Et on repasse aux Stooges avec «When Fate Deals Its Mortal Blow», c’est battu et rebattu à la stoogerie et ça continue comme ça jusqu’à la fin, avec l’apothéose, «We Had Love», qu’ils font littéralement exploser sur les accords de Gloria. Comme dit Kim : six strings in one sound !

Si on aime les Scientists et qu’on dispose d’un budget confortable, alors ils faut rapatrier tout ce que sort le petit label basque Bang!, à commencer par Rubber Never Sleeps, un double album qui propose des bouts d’enregistrements live de la grande époque. En B, on tombe sur une version vivace de «Swampland», complètement saturée de basse par un Boris qui semble jouer la carte de la destruction massive. Dans «I’ve Had It», il fait gronder sa basse comme le dragon de Merlin, sous la surface de la terre. En C, on tombe sur une version explosive de «We Had Love», merveille d’excitation brutale, classique scientifique pur, bouillonnant et ravagé par ces charges héroïques. Ils font aussi une brillante reprise du «She Cracked» des Modern Lovers.

Une autre compile intitulée Pissed On Another Planet rassemble les premiers titres des Scientists. Dans les notes de pochette, Kim Salmon rappelle qu’au démarrage, il avait une idée claire du son qu’il voulait en tant que guitar head : Steve Jones ou Johnny Thunders. Pas étonnant que le cut qui donne son titre à la compile sonne comme un hit des Heartbreakers : même son et même magie au chant. Kim Salmon est l’un des meileurs caméléons de l’univers. Il sait reproduire le jouissif des Heartbreakers, cette fantastique foison de gros accords rockyrollah. On trouve aussi le premier single du groupe, Frantic Romantic», dont Greg Shaw avait acheté 500 exemplaires pour le diffuser via Bomp! Magazine. Cette power pop vitupérante n’a rien perdu de sa fraîcheur et en 2016, Kim peut encore jouer ce morceau sans problème. On sent bien qu’à l’époque, les Scientists trempaient dans la power pop à la Nerves. Il suffit d’écouter «Shake Together Tonite». C’est grouillant et vivifiant. Même chose avec «last Night». Ils vont dans des tas de directions, mais ils savent rester dans le musculeux harmonique. Un cut comme «It’s For real» éclate au grand jour, c’est plein de guitares et très impressionnant. Ces mecs sont à l'aise, ils sont déjà très complets. Avec «larry», Kim se prend pour un punk anglais. Il chante un peu cokney. On croirait entendre les Small Faces. Dans «Teenage Dreamer», il évoque les New York Dolls. Le riff évoque celui de «Death Party» du Gun Club et «Shadows of The Night» sonne comme un hit des Stiff Little Fingers. Quelle palette !

Kim va jouer quelques années dans les Beasts of Bourbon, un groupe qui a la sale réputation d’avoir accueilli en son sein tous ceux qui avait besoin de quick beer money. Kim était encore dans les Scientists quand il joua de la guitare sur The Axeman’s Jazz, le premier album des Beasts. Le morceau phare de l’album s’appelle «Evil Ruby», qui sonne comme un gros clin d’œil aux Stones. Car on y entend les accords de «Let It Bleed» et Tex Perkins chanterait presque comme Jagger. Ils font aussi une brillante reprise du «Graveyard Train» tiré du premier album de Creedence. La grande force des beasts fut de pouvoir sonner sur certains cuts comme Beefheart. Bel exemple avec «Save Me A Place», très beefheartien dans l’esprit. Kim et Spencer P Jones sortent les accords magiques du Magic Band et jouent au heavy groove. En prime, Tex Perkins screame superbement. Mais c’est tout. Pour le reste, on peut se rhabiller.

Leur second album Sour Mash est un peu plus solide. Ils démarrent avec une fabuleuse reprise du «Hard Work Driving Man» de Jack Nitzsche et Ry Cooder qu’enregistra Captain Beefheart pour le film Blue Collar de Paul Shrader. Tex Perkins chante cette merveille avec la voix d’un esclave noir à bout de nerfs. Les Beasts montrent là une belle propension à la heavyness maximaliste. On retrouve ce penchant beefheartien en B, dans «Driver Man», une belle dérive des continents de l’incontinence digne du bon capitaine. C’est du pur jus et en prime, ça saxe. Il faut aussi écouter «Pig», un chef-d’œuvre primitif joliment agressif. Tex Perkins peut grogner comme Wolf, il a le même sens du danger et de la menace. Voilà encore une pure énormité. Tex Perkins avait autant d’allure au plan vocal qu’au plan physique. Il faut le voir sur les photos du groupe avec ses têtes de loup et son regard noir. Fantastique présence ! Oh, ils font aussi une reprise de Merle Haggard, «Today I Started Loving You Again», country-rock sombrement aguichant.

Leur troisième album Black Milk entre dans la catégorie des grands albums de rock classique. Tous les cuts de cet album beaucoup plus calme sonnent comme des hits. Dès «Finger Lickin’», ils renouent avec un sens beefheartien des choses, dans le son comme dans le beat, dans l’intention comme dans le mystère. On va de balladif en balladif, mais tout est incroyablement inspiré, sur ce disque, indiciblement sombre («Hope You Find Your Way»), plombé et sans espoir («Word From A Woman»), et même hanté et puissant, comme c’est le cas avec «I’m So Happy I Could Cry», où ils tendent vers le calme qui accompagne les tout derniers instants de vie. Tex Perkins chante admirablement le groove de Beast qui s’appelle «You Let Me Down». On entend surtout la basse de Boris. Et en B, ils démarrent en force avec une version pétaudière du «Lets Get Funky» de Hound Dog Taylor. Tex Perkins rigole sur le beat furibard et il relance à coups de cris de guerre, yeah yeah ! On revient à l’excellence paisible avec «A Fate Much Worse Than Life», monté sur un beat de valse et finement souligné à l’accordéon. Kim compose «Blue Stranger» et Tex le chante au clair de la lune. C’est visité par un solo de jazz infernal. On reste dans l’excellence pure et dure avec le très cajun «Blanc Garçon» - I am bonnet blanc garçon - pur jus du bayou et on passe au mélopif crépusculaire avec «Execution Day», un cut insistant et buté, fabuleux car bien dosé et avenant. Ça sonnerait presque comme un grand hit d’Iggy. Par la qualité de ses morceaux , cet album se révèle absolument exceptionnel.

Le quatrième album des Beasts s’appelle The Low Road. Ils ouvrent le bal avec «Chase The Dragon», joli groove druggy, joué à l’aune du vieux gimmickage de la grassouille. Le morceau titre vaut pour une belle compo longiligne et chargée de son. On y retrouve l’implacabilité des choses qui semble vouloir caractériser le groupe. Et avec «Just Right,» ils passent à l’hendrixienne avec un fabuleux solo d’intro signé Spencer P. Jones. D’ailleurs, au dos de la pochette, on les voit tous les trois sur scène, Tex Perkins, Kim et Spencer, complètement démantibulés par leur chaos sonique, avec les cheveux en l’air. Il faut attendre «Straight Hard & Long» pour renouer avec la furia, celle du MC5. Ils la traitent au mode stop/break down, couplet chant sans vague, et puis ça lâche d’un coup, et quand ça lâche, ça lâche, avec Kim et Jones aux manettes de la moulinette. Ils semblent évoquer les élans d’une bite en émoi, mais dans l’exaction de la pure folie. Ces mecs sont capables d’aller gratter la gale des dieux. On tombe à la suite sur un fantastique garage-cut signé Kim, «Something To Lean On», épais et bien amené, qui monte comme la marée du diable, noire et rouge, infernale et bien touffue, quasiment scientifique - You’re my love and my dealer - Romantisme des ténèbres, avec un beat de fond de studio. On applaudit les Beasts.
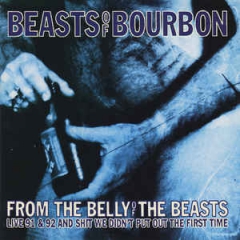
From The Belly Of The Beasts est un double album qui propose du live 91 et 92 et des cuts inédits. Tellement bon qu’il est condamné à finir sur l’île déserte. Ils redémarrent avec un «Chase The Dragon» lourd de conséquences, avec un son en forme de mur du son, c’mon, barrage de riffs, personne ne passe. Sacré clin d’œil aux Doors avec «Save Me A Place» monté sur un monstrueux groove de bassmatic et harcelé par des attaques de guitare sur les côtés. C’est même concassé par des breaks stoogiens, et ça part dans le son des Doors, avec ce groove qui rappelle l’I can hear the scream of the butterflies, fantastique improvisation des choses, ils poussent bien le bouchon. Ces mecs avaient tout compris, aussi bien au niveau des ambiances que du décorum. Ils passent à la stonesy avec «Drop Out», du pur Kim et ça sonne comme un hit. On retrouve l’excellent «Straight Hard & Long», attaqué au sans pitié. Kim et ses hommes lancent des assauts et halètent comme des chiens. Les riffs sont hallucinants de violence, Kim et les bêtes avaient du génie. Ils font une spectaculaire reprise du «Let’s Get Funky» de Hound Dog Taylor. Quelle pétaudière ! Kim outrepasse Hound Dog, il explose l’art du vieux rescapé des plantations. Le disque 1 se termine avec trois cuts sans Kim dont l’excellent «Good Times» chanté à l’arrache et joué high energy. Sur l’autre disque se nichent trois reprises de haut rang, le «Dead Flowers» des Stones que Tex attaque à la grosse voix et que le groupe joue très musclé à la ragged company, puis «Dirty Water», solidement charpentée, avec un Tex qui écrase sa voyelle du talon comme un lombric pour que ça gicle dans l’I’m gonna tell you a story, et «So Agitated», version atrocement heavy du vieux cut des Electric Eels, doté du plus liquide des solos et du plus tribal des beats d’extrême onction. Oh ils tapent aussi dans Hank Williams avec «Ramblin’ Man» et dans les Pretties, seigneurs des annales, avec une version somptueuse d’«ESP».
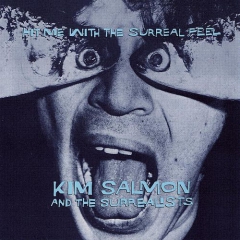
Avec ses copains les Surrealists, Kim commence à enregistrer en 1988 une série d’albums très ambitieux. Le premier s’intitule Hit Me With The Surreal Feel. En guise de clin d’œil à Captain Beefheart, Kim se fait photographier avec deux poissecailles devant les yeux. On retrouve sur ce disque tout le côté malsain insidieux qui faisait le charme maudit des Scientists. Bel exemple avec «Bad Birth», sa magnifique ambiance pesante et sa guitare en état d’alerte rouge. Franchement c’est admirable. On a là une énormité scientifique traitée à la pure tension de guitare et de basse, un climat digne des Chrome Cranks, c’est du pur jus de déflagration. Kim Salmon reste un artiste profondément dérangeant. Il est réellemet le maître de la menace cisaillante. C’est un puisant prévaricateur. Il faut attendre «Intense» en B pour renouer avec l’intensité. Voilà un cut monté au heavy riff scientifique et hanté par des sacrés coups de guitare frelon en folie. L’ami Kim gueule dans la mélasse, c’est un allumeur d’incendies patenté. Plus loin, on tombe sur «The Surreel Feal» joué à la bonne basse et chanté à la ramasse scientifique. Mais quel son de basse ! Kim fait aussi une belle reprise du «Devil In Disguise» d’Elvis et boucle avec un «Surreal Feal» toujours aussi bien joué par le bassman Brian Hooper. Quel bassman baby !

Excellent album que ce Just Because You Can’t See it Doesn’t Mean It Isn’t There paru un an plus tard. Kim nous embarque pour Cythère dès «Measure Of Love». Ce mec est un finisseur de cuts, il ne laisse rien dans son assiette. Il ramène toujours un énorme son de basse, qui est l’ingrédient fondamental. Il passe à la sunshine pop avec «Sundown Sundown». Avec Kim, il faut s’attendre à tout, surtout à ce genre de plan extraordinaire, il nous roule sa pop dans une distorse de génie et ça vire à la mad psychedelia. Encore un coup de génie avec «Sunday Drive», pure exaction scientifique, de la vraie rémoulade de Romulus avec une voix en chuchotis. Kim cisaille le réel, il étend son empire et devient le maître universel des ambiances scientifiques, il défie la morale, ça rampe et ça grouille sous le couvert. Il enchaîne avec un «Je t’aime» joué aux accords de Gainsbarre. On assiste là à l’incroyable hommage d’un homme éclairé à un autre homme éclairé. Une fille fait des bruits. Ça se frotte dans les culottes. Kim pousse le jus mélodique de Gainsbarre dans les extrêmes. Et puis à la suite, on retrouve les cuts de l’album Hit Me With The Surreal Feel, et ces merveille que sont «Bad Birth», «Belly Full Of Slys», «Intense» et «Surreal Feel» dont le violent groove de basse continue de hanter les régions reculées du cerveau.

On trouve deux belles pièces de choix sur Essence paru en 1991, à commencer par «The Cockroach», qui n’est pas le cafard de Charlie. C’est un autre genre de cafard, dissonant et un peu Dada sur le pourtour. «Self Absolution» se veut encore plus Dada dans le dedans. Cette merveilleuse pop ambitieuse semble déployer des ailes rognées de papillon mité. Et pourtant Tony Pola bat. Petit retour à l’Howard’s End de l’esprit scientifique avec «A Pox On You», une belle pop tendue à se rompre, car gothique et inspirée par les trous de nez. En B, Kim vire plus pop avec des trucs comme «Lightning Scary», farci de breaks de talking rap, ou encore «Essence Of You», plus éthéré et même quasiment à l’arrêt. Kim adore dérouter les cargos. Il retrouve quelques vieux réflexes d’agressivité scientifique dans «Looking At The Picture». On se régale par essence et on se lance dans la partance de sa prestance. Il termine ce bon album avec un «26 Good Words», plongé dans une ambiance extraordinaire, encore un cut monté sur une idée brillante, la fameuse idée ampoule des pictos qui éclaire les pas dans les ténèbres du septième cercle. Kim vire hypno avec une élégance non feinte.
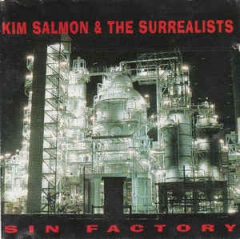
On trouve encore des preuves de l’existence du dieu Kim sur Sin Factory paru en 1993. Eh oui, il faut bien se faire à cette idée : Kim Salmon n’enregistre que des bons albums. Rien que des bons albums. Et pouf, il démarre avec un spectaculaire «I Fell», doté d’un joli son de basse et d’urgences de bas de manche. Kim connaît les ficelles du génie. Son cut est un modèle du genre, avec un pur son de blues-rock illuminé aux feux de plaine, il marmonne ses plaintes grasses et part en vrille de tourbillon sonique de plaie d’Egypte. Sainte-Marie Mère de Dieu protégez-nous de ce démon maléfique ! Mais non, elle ne peut pas nous protéger d’un cut comme «Gravity», car Kim envoie de violentes giclées scientifiques dans l’air chaud. On patauge en plein dans le mythe épais des Scientists, avec un son saturé de basse et des climats privés d’avenir. Kim hurle dans la clameur de la fin du monde et claque des départs gimmickaux dévastateurs. Encore un cut affreusement génial avec «Feel». Pas compliqué, Kim Salmon, c’est le Max la Menace du garage, c’est Jo le Cambouis, le redresseur de stomp et le décrasseur de carburateurs. L’infernal Kim Salmon surmonte toutes les difficultés, il sait anticiper l’apocalypse, la vraie, celle des quatre cavaliers. Il ne vit que pour les ciels chargés. Encore un heavy groove allumé aux gimmicks maléfiques avec «Come On baby». C’est sans doute ce qu’il sait faire de mieux. Il va même hurler au coin du bois. On reste dans le même esprit avec «Non Stop Action Groove», Kim Salmon pose ses yeah comme des jalons dans un délice de jouvence. Avec le non stop action groove, il sait de quoi il parle. Quel extrapolateur définitif ! Il joue ça à l’urgence de la note gluante !
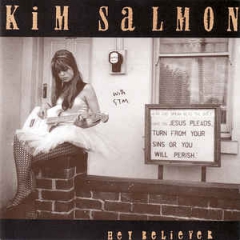
Un an plus tard paraît Hey Believer. Warren Ellis fait partie de l’aventure. Sautez tout de suite sur sa version de «Ramblin’ Man» qu’il attaque au son mal isolé. Son boogie rampe dans une flaque de sang. C’est admirable de dégueulerie. Il chante ça à la glotte tuméfiée, il dégueule tout ce qu’il peut. Voilà enfin un mec qui sait chanter le boogie comme il faut. Pur génie. Il faut aussi écouter «Hey Believer», il croone à l’imparabilité des choses, il en a les moyens et pas des petits moyens, non, les siens sont astronomiques. Il affiche une classe surnaturelle et on tombe sous le charme. Belle pièce aussi que le cut d’ouverture, «Reach Out», balayé par des guitares déflagratoires, comme au temps béni de Tony Thewlis. Kim nous ramène au bord de son cher précipice et livre une pièce d’une insondable profondeur. Avec «Obvious Obvious», il rend hommage à Dylan, il part en groove de croon et soigne une diction purement dylanesque. Il revient au very big atmospherix avec «You Know Me Better Than That». Il sait que c’est foutu d’avance, car trop underground, comme le sont les Chrome Cranks et Gallon Drunk, mais il y va quand même de bon cœur. Il sait faire preuve de bon sens et d’intégrité supra-normale. Il sait travailler ses cuts à coups d’ah c’mon ! C’est un fieffé leveur de levain - Ahh c’mon you know you’re better zan zat ! - Dans «Pass it On», il pique une violente crise de wha-wha. Il réveille le Krakatoa et en profite pour passer un killer solo qui porte bien son nom. Retour au rampant avec «Treachery», mais du rampant complètement insidieux. Il le traite sur le mode de la perte de raison. Il hurle dans la salive d’une glotte en sang et invente une nouvelle forme de génie : le génie des catacombes. Ça tourne à l’épreuve de force extravagante. Il travaille la pire des sous-gammes de raclements de gorge, il nous emmène dans une cave sans lumière, nous interdit l’avenir et même l’air, même si ça reste terriblement inspiré.

C’est assez bête à dire, mais le Kim Salmon & The Surrealists paru en 1995 est encore un album indispensable. Ne serait-ce que pour cette stoogerie intitulée «Redemption For Sale» - There’s a cost to be paid by you - On y savoure l’énormité des écarts de conduite. Oui, le cut est complètement dévasté par le son. Il est monté au groove rampant et c’est là l’un des meilleurs hommages aux Stooges qui se puisse imaginer ici-bas. Hommage complet avec ses crises de palu et son dégueulis groovy. Voilà le paradis du lapin blanc. Avec ce hot hit, Kim rallumait la chaudière des Stooges. Il faut l’entendre gueuler Do it d’une voix de cancéreux à l’agonie. Autre coup fumant, «I’m Gonna See You Compromized». Kim et ses deux amis prennent ça au boogie blues du Mississippi. Oui, ils savent le faire. Kim s’amuse même à réinventer le boogie. Il se l’octroie. Il se l’accapare. It’s awite ! Et tout à coup il vomit Yeahhh I’m your own ! - Voilà le boogie de nos rêves inavouables. Il faut aussi écouter «It’s Your Fault», le cut de fin, car c’est du scientifique à l’état pur. On y entend une grosse ligne de basse vénéneuse circuler dans la boue du groove. Kim avance en poussant des Yeah ! Yeah ! Le son se noie dans le jus de basse. Kim a toujours su faire sonner une basse, sur ses albums. On retrouve avec Fault toute la démesure de «Solid Gold Hell». Et puis, on trouve encore d’autres merveilles au fond de cette caverne d’Ali-Baba, comme «I Wish Upon You», joli stomp industriel frappé au marteau pilon des forges et joué à la guitare cromagnon. C’est Brian Henry Hooper qui joue de cette basse un peu métal. Autre pure énormité : «What’s Inside Your Box». Oui, car elle sonne tout simplement comme un balladif de pop interplanétaire. Ampleur garantie. Il faut parfois savoir se rendre à l’évidence. C’est joué aux guitares persuasives, celles dont les Stones ont toujours rêvé. Il se dégage en effet de ce chef-d’œuvre de forts accents de Stonesy. Kit sait conduire un hit vers les cimes de l’underground. D’ailleurs, dès que Kim Salmon joue quelque chose, ça accroche. La preuve ? «Draggin’ Out The Truth». Dès les premières notes, on a l’oreille qui frétille. Car voilà un son puissant, inspiré, scientifico-stoogy. Et ce mec chante comme une superstar, à la croisée d’Iggy et du croon. Il fait aussi une reprise de son «Frantic Romantic» et profite de l’occasion pour le muscler un peu. Avec «Plenty More Fish», il montre tout simplement qu’il ne craint pas d’affronter le destin. Sur ce disque, ils ne sont que trois et ils alignent hit sur hit. «Intense»... Tu parles d’un titre ! Évidemment, il en profite pour marteler. C’est de bonne guerre, avec un titre comme celui-là. C’est même assez brutal. Avec Kim, ça prend forcément des proportions extraordinaires. Il fait même sauter les compteurs et danse le jerk de l’apocalypse.

Ya Gotta Let Me Do My Thing paru en 1997 est un double album donc double dose de Kim. Et comme si ça ne suffisait pas, Jim Dickinson produit. Inutile d’ajouter que cet album figure parmi les classiques du rock moderne. Car dès «Won’t Tell» qui ouvre le bal, on comprend tout. Ce cut bien amené au petit stomp est chanté à deux voix sur une brillante idée de tension maximaliste. Une fois de plus, on est obligé de parler de génie. Impossible de faire autrement. En plus, il truffe sa syncope de cuivres. Puis il renoue avec le rampant scientifique dans «The Zipper». De toute évidence, Kim cherche la petite bête dans la noise. Il faut voir comme ça rampe dans la pénombre primitive - Down to the zippah - Joli groove de basse. Dans le morceau titre, on entend un solo de flûte. Kim aura tout tenté. Et avec «Alcohol», il reprend de l’altitude - Let’s try to get it back ! - Kim sait faire sonner sa basse ! Encore une belle énormité avec «The Lot», pur jus d’énerverie gorgé de riffing névralgique et éclaté aux gémonies. En prime, Kim nous fait le coup du départ en killer solo. Dans «Guilt Free», il évoque l’histoire d’un homme et de son combat avec sa conscience. Chez Kim tout est intéressant, même les combats. Il reste encore une belle énormité sur le disque 1, «But You Trust In Me», qui sonne comme un Dead Flowers alcoolisé. C’est exactement le même drive. On sent bien la patte de Jim Dickinson. Démarrage en force sur le mini-disk 2 avec «You’re Such A Freak», un joli balladif bien gratté à la basse et mélodiquement superbe. Kim sait créer les meilleures conditions de l’ambiance. C’est même tout ce qu’il sait faire dans la vie. Avec «I’m Evil», il renoue avec la ferveur dylanesque et produits des éclairs de chant insistants. Quel extraordinaire touche-à-tout ! Retour au gros scientifisme avec «Hey Mama Little Sister», cut sale, solide, musculeux, garagiste, superbe d’épaisseur, ce qui peut paraître logique quand on met deux pointures comme Kim et Jim dans un studio. Kim passe ensuite au psyché à la ramasse avec «Radiation» et il boucle avec «A Good Parasite Won’t Kill Its Host», cut expérimental monté sur un groove de machines et tartiné d’un dégueulis de wha-wha. Kim suicide son son, il visite les sous-sols du groove et il sort un son qui évoque le lance-flamme des nettoyeurs de tranchées. En gros, il visite les neuf cercles de l’enfer.

Nouvel épisode avec un groupe baptisé The Business et un album intitulé Record qui paraît en 1999. L’album vaut le détour pour deux raisons. À commencer par «Disconnected», sanctionné par un heavy riffing mal intentionné et animé par de petits accents sauvages. C’est le Kim qu’on préfère, le loup qui rôde dans la bergerie du groove, avec des yeux méchants et de la pure violence dans le chant. Il faut le dire et le redire : Kim Salmon sait créer l’événement. L’autre raison, c’est «Emperor’s New Clothes», un cut pop-rock embarqué sur un énorme riff de basse. On est convaincu d’avance. C’est joué à coups de basse rageurs et Kim chante à la meilleure mode de Melbourne - That’s how it goes - On dirait même qu’il extrapole le son. Un vrai miracle. D’autres cuts accrochent bien l’oreille comme «Anticipation», scientifique en diable, mauvais et sale, chanté derrière la porte, comme s’il préparait un mauvais coup. Quelle définition de la science ! Kim replonge le rock dans le chaudron du gore et il injecte dans sa fournaise tout un essaim d’abeilles. C’est assez stupéfiant. Avec «Give Me Some Notes Mike», il passe au funk, mais un funk extraordinairement décalé. Avec son équipe, ils se prennent pour Parliament ! Et puis encore une surprise de taille avec «New Kind of Angel», un groove bizarre orchestré aux trompettes mariachi. Ça donne un son intense, comme enflammé de l’intérieur, bien allumé à la basse. Il fallait y penser : basse, trompettes, cocktail exotique et parfait.
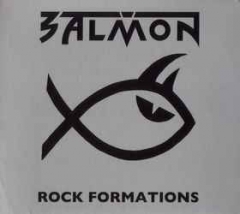
Retour de Kim Salmon sans les Surrealists en 2007 pour un album à la Glenn Branca intitulé Rock Formations. Ce double album propose des instrus joués par cinq guitaristes et deux batteurs. Un truc intitulé «ETI» sort du lot, car le thème éblouit par sa beauté. Kim et ses amis créent une ambiance fantastique orientée sur l’espace et ses mystères. On trouve d’autres choses intéressantes comme ce «Punk Fatwa» qui sonne comme un assaut sauvage à la foire à la saucisse. Kim tente l’aventure avec des intros furibards et ça marche. Place aux aventuriers ! «It Wears A Kilt» ensorcelle avec sa note tirée qui sonne comme le chant d’une sirène. On sent clairement le brillant d’une idée. Kim Salmon fonctionne exactement comme Robert Pollard : à l’idée pure. Il faut écouter son «Alien Chord Orchestra» : c’est joué au big atmospherix tendancieux, avec une volonté très nette de créer la peur. En B, il nous fait la grâce de jouer une reprise lumineuse du «Maggot Brain» de Funkadelic. Et le «Guitarmony Suite» qu’on trouve en D vaut tout l’or du monde.
Comme tous les albums de Kim à venir, Rock Formations est sorti sur Bang!, un petit label basque spécialisé dans les Scientists et le Gun Club.

Grand Unifying Theory est le dernier album en date de Kim avec les Surrealists. Encore un bon album. On y trouve une pure stoogerie, «Childhood Living», qui débouche sur une atmosphère à la Dolls avec des clap-hands et ça s’endiable, Kim claque le baigneur du meilleur rock de percus. Il est stoogien, à la vie à la mort. Autre coup de Jarnac avec «Predate», monté sur une pulsation démentoïde. Voilà l’un de ses traits de génie : sortir un cut stoogy au débotté, on a là le beat de «1969», c’est tout simplement monstrueux de mimétisme véridique. Encore un coup direct. Kim n’est autre que l’uppercut man du rock moderne, le brasero du rock faithfull, l’homme du pas de cadeau. Il faut aussi écouter ce «Turn Turn» d’ouverture monté au groove de basse, véritable énormité démonstratrice et parallèle. On frise le gras scientifique. Avec «EQ1», Kim nous replonge le museau dans la violence du néant. On croit entendre une charge de cavalerie. Voilà ce qu’il faut bien appeler un retour aux penchants scientifiques. Kim traite ça à la hurlette bestiale, il semble vouloir rameuter tous les démons du rock. Avec les deux parties de «Grand Unifying Theory», Captain Kim nous emmène en voyage tripal dans le néant. Ça dure 21 minutes, on file vers l’inconnu, mais ça reste très intéressant.
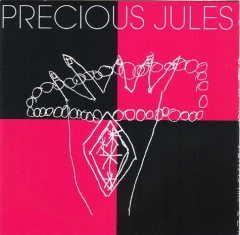
Et 2011, il monte Precious Jules avec Michael Stranges et enregistre l’album du même nom. Force est d’admettre que l’album vaut - une fois de plus - son pesant d’or. On y trouve un véritable hit glam, «Shine Some Darkness On Me» - C’mon shine some darkness down on me - et un classique swamp-rock, «The Urban Swamp», où on entend arriver les alligators. Kim sait de quoi il parle. Il croone son boogaloo, in the swamp, mais pas celui de Tony Joe, the urban swamp. Il crée les conditions d’une magnifique configuration de suspense. Il sait tourner un cult movie en trois minutes. On trouvera aussi trois véritables coups de génies sur cet album, à commencer par «The Precious Jules Theme» d’ouverture. Kim sort tout l’attirail du stomp et roule des r. On retrouve l’esprit inventif du vieux scientifique. Il attaque «A Necessary Evil» en lançant let’s get wasted ! Quel élan ! Il sait tailler sa route. Il se fâche même un peu et ça claque des mains. Precious Jules sonne comme un nouvel El Dorado, et on entend des chœurs de Dells sur la fin du cut. Coup de génie encore avec «Too Uptite» joué à la distorse maximale sur un beat funk. Kim va chercher des effets inédits. Il semble même perdre le contrôle et il part en dérive de syncope. Voilà une nouvelle façon de swinger le garage funk. Il chante aussi «You’re A Backlash» d’une voix de black des bas-fonds. Sacré Kim, il ne peut pas s’en empêcher. C’est visité par un solo gangrené. On appelle ça de la classe souterraine. On l’entend aussi gratter ses accords à l’aveuglette dans «Seein’ Spots». Écoutez les disques de Kim, il sera toujours au rendez-vous.
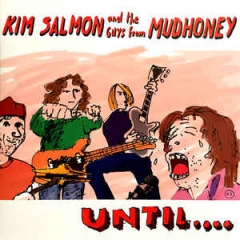
Il devait jouer dans Mudhoney, à l’époque où Steve Turner ne voulait plus tourner. Puis le projet a capoté quand Steve Turner a décidé de revenir dans le groupe. C’est cette histoire dessinée en bd qu’on découvre dans Until, l’abum de Kim Salmon & Mudhoney paru sur Bang! en 2011. Kim s’est bien amusé à dessiner cette histoire. Oh ce n’est pas un grand dessinateur, mais on peut dire qu’il a un certain style. Les morceaux enregistrés pour le projet tiennent bien la route, comme ce «I’ll Be Around» d’ouverture bien tenu à la sourdine avec un beau son de basse feutré. L’ami Kim y pulse bien son groove scientifique. On tombe plus loin sur «I Wanna Be Everything», un fantastique balladif. C’est là qu’on mesure l’énormité du mythe salmonien. Ce mec a des idées brillantes et ce cut sonne comme le grand hit planétaire inconnu. Kim chante avec de faux accents de Bowie dans la voix. En B, on tombe sur «The Goose», joliment embarqué au groove de basse par Matt Lukin, le vieux bassman de Mudhoney. Kim fait du Scientism avec les grungers de Seattle. Il leur enseigne l’art de groove de la menace.
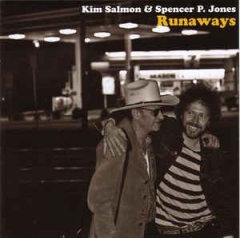
Kim Salmon & Spencer P. Jones enregistrent Runaways en 2013. Fantastique album ! Ils tapent une reprise ultra-inspirée du vieux hit de Wolf, «I Asked For Water». Ils ramènent du son au rendez-vous. Kim casse bien sa voix pour créer la pyschose. Ils enchaînent avec une reprise des Stooges, «I Need Somebody». L’incroyable de la chose, c’est que Kim chante comme Iggy. Il est dessus, avec du rab de guitares électriques. Comme c’est inspiré ! Comme c’est bien vu ! On gagne énormément à fréquenter un mec comme Kim. S’ensuit «It’s All The Same», un joli balladif digne de tous les honneurs, hanté par de faux airs d’«It’s All Over Now Baby Blue», c’est dire la classe du cut. Encore une reprise de rêve avec «Jack On Fire» du Gun Club, et une version laid-back incroyablement démente. Kim en fait un groove de blues dégoulinant de génie. Il chante ça sous le manteau. C’est atrocement bon. Sans doute la plus belle reprise du Gun Club. En B, avec «Loose Ends», Kim s’embarque dans un talking blues à la Lou Reed. Mais c’est dommage, car la B ne vaut pas l’A. Les cuts défilent et puis c’est tout.

Toujours sur Bang!, Kim vient de sortir son nouveau double album solo, My Script. Il y chante de gros hits glam comme «Destination Heartbreak», admirable d’allure altière, ou encore «Client JGT683», pop-rock magistrale hantée par un son de guitare à la Mick Ronson. C’est le son vainqueur, radieux, ondoyant qu’on adorait à la l’époque des Spiders. Kim chante ça avec un art consommé. Rien que pour ces deux cuts, l’album vaut l’achat, même s’il est cher - les albums Bang! comptent parmi les plus chers, mais les pochettes sont travaillées et les notes bien documentées. On trouve une autre merveille en début de C, «Already Turned Out Burned Out», gorgée de fuzz glam et hantée par une basse survoltée. Kim y part en solo et joue comme un dieu. La chose tourne vite à l’élévation mystico-sonique. Il faut aussi écouter le fabuleux «It’s Sodistopic». Kim y travaille le son avec une sorte de mauvais génie et fait monter la basse devant dans le mix. C’est lui qui joue tous les intrus. Ce disque est absolument passionnant de bout en bout, à condition bien sûr d’apprécier les aventuriers. Il ouvre la D avec un «Gorgeous And Messed Up» merveilleusement ambitieux et il fait le robot dans «Tell Me About Your Master».
Signé : Cazengler, le riki-Kim
Kim Salmon. La Féline. Paris XXe. 11 juin 2016
Scientists. Scientists. EMI Custom Records 1981
Scientists. Blood Red River. Au Go Go 1983
Scientists. This Heart Doesn’t Run On Blood, This Heart Doesn’t Run On Love. Au Go Go 1984
Scientists. Rubber Never Sleeps. Au Go Go 1985
Scientists. You Get What You Deserve. Karbon 1985
Scientists. Weird Love. Karbon 1986
Scientists. The Human Jukebox. Karbon 1987
Scientists. The Human Jukebox 1984-1986. Citadel 2002
Scientists. Pissed On Another Planet. Citadel 2004
Scientists. Sedition. ATP Recordings 2007
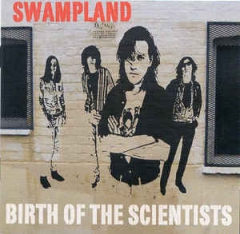
Scientists. Swampland. Bang! Records 2008

Scientists. This Is My Happy Hour (Birth Of The Scientists). Cherry Red 2010
Beasts Of Bourbon. The Axeman’s Jazz. Big Time 1984
Beasts Of Bourbon. Sour Mash. Red Eye Records 1988
Beasts Of Bourbon. Black Milk. Red Eye Records 1990
Beasts Of Bourbon. The Low Road. Red Eye Records 1991
Beasts Of Bourbon. From The Belly Of The Beasts. Red Eye Records 1993
Kim Salmon & The Surrealists. Hit Me With The Surreal Feel. Black Eye Records 1988
Kim Salmon & The Surrealists. Just Because You Can’t See it Doesn’t Mean It Isn’t There. Black Eye Records 1989
Kim Salmon & The Surrealists. Essence. Red Eye Records 1991
Kim Salmon & The Surrealists. Sin Factory. Red Eye Records 1993
Kim Salmon & STM. Hey Believer. Red Eye Records 1994
Kim Salmon & The Surrealists. Kim Salmon & The Surrealists. Red Eye Records 1995
Kim Salmon & The Surrealists. Ya Gotta Let Me Do My Thing. Half A Cow Records 1997
Kim Salmon & The Business. Record. Half A Cow Records 1999
Kim Salmon. Rock Formations. Bang! Records 2007
Kim Salmon & The Surrealists. Grand Unifying Theory. Low Transit Industries 2010
Precious Jules. Precious Jules. Battle Music 2011
Kim Salmon & Mudhoney. Until. Bang! Records 2011
Kim Salmon & Spencer P. Jones. Runaways. Bang! Records 2013
Kim Salmon. My Script. Bang! Records 2016
*
« Allo !
- Ah Damie ! Je croyais que tu m'avais oubliée !
- Mais non, mais non ! Tu es inoubliable !
- Oui, des mois que tu ne m'as donné de nouvelles !
- Totalement indépendant de ma volonté, baby. Tu sais la vie d'un rocker est très dure, concerts, disques, bouquins, revues, l'on n'en vient jamais à bout !
- Oui, mais tu pourrais tout de même penser un peu à moi, je...
- Justement, est-ce que ça te dirait un petit bain sur la Seine ?
- Ne sois pas timide Damie, si tu veux me voir en monokini, dis-le directement, je t'attends dès ce soir dans ma chambre.
- Non, non, je suis très sérieux un petit bain mercredi soir sur la Seine !
- Mais tu es complètement fou, avec ce froid de canard, arrête de plaisanter !
- Tout ce qu'il y a de plus sérieux, ma baby belle, mon fromage d'amour, je compte sur toi.
- Fuck ! »
J'ai ressenti comme un soupçon d'hystérie typiquement féminine dans ce dernier vocable. Qu'à cela ne tienne, je suis allé voir ma vieille et fidèle copine stationnée devant la maison.
« Hello teuf-teuf !
- Salut Damie, quel est le programme pour ce soir ?
- Les Pogo Car Crash Control
- Super, j'adore ce groupe ! Te rends-tu compte qu'ils ont mis le mot voiture dans leur appellation contrôlée. Eux au moins ils savent honorer la gent automobile ! Allez, zou on part tout de suite ! »
Et voici comment et pourquoi, deux heures plus tard je me pointais ce mercredi 25 / 01 /2017 au :
PETIT BAIN / PARIS
DÄTCHA MANDALA / JAMES LEG
POGO CAR CRASH CONTROL
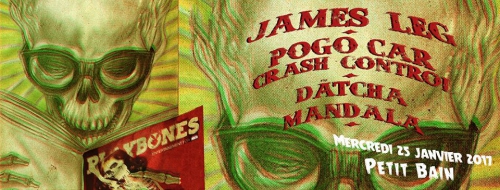
Franchement à dix-neuf heures trente il ne fait pas chaud sur les quais de Seine au pied de la très grande Bibliothèque François Mitterrand. Faut être un peu barge pour s'y promener, d'ailleurs en toute logique le Petit Bain est une barge amarrée – fluctuat nec mergitur - sur les bords de l'antique Lutèce chère à Julien, notre dernier imperator, reconvertie en restaurant et salle de concert.
L'espace n'est pas grand mais aménagé et pensé avec intelligence, l'on s'y sent bien, mais petit défaut inhérent à sa structure originelle, la scène est un peu étroite. Le public est là. Des connaisseurs.
DÄTCHA MANDALA

Les gros Marshalls qui encadrent la scène laissent présager que l'on ne va pas assister à un concert de flûtes à bec. Toutefois les tapis disposés sur le sol et toute une série d'objets indiens disséminés avec soin attirent les regards et m'assaillent de quelques craintes. Mandala ! Pourvu que l'on ne se retrouve pas avec des adeptes de Ravi Shankar ! Nos craintes seront vite balayées. JB Mallet s'installe derrière sa batterie, Jérémy Saigne s'empare de sa guitare, et Nicolas Sauvey est à la basse. Et au chant. Surtout au chant. Cheveux frisés, veste à franges, et la voix, aigüe en diable qui monte haut, et qui cascade en secousses telluriques. Le spectre Led Zeppelin s'impose à tous. Il est des fantômes qu'il vaut mieux laisser reposer en paix. N'atteindront jamais au cours de leur set la puissance apocalyptique du Dirigeable mais ils tireront leur épingle du jeu et démontreront que loin d'être une pâle imitation ils possèdent une personnalité intrinsèque et créatrice qui ne demande qu'à s'épanouir.
Si Nicolas attire les regards ses deux acolytes ne restent pas inactifs. Il s'agit bien d'un power trio et chacun a intérêt à assumer sa charge. Chacun son rôle, mais la musique qu'ils édifient exige une extrême attention. Jérémy reste concentré, les yeux fixés sur ses mains, la flamboyance d'un riff tient avant tout à sa précision, sa force lyrique procède de l'ensemble du groupe, l'appui drumique est essentiel en cela, JB, est aux aguets, lui incombe la tâche de porter ces coups de boutoirs qui doivent être aussi des contreforts inébranlables. Peu de roulements destinés à construire un mur du son de base, préfère nettement une frappe d'intervention qui soutient, achève et sculpte le riff, l'accompagnant de bout en bout tout en en marquant surtout la finitude, c'est lui qui clôt la séquence, d'un battement de suspension agonisique qui laisse l'espace de silence nécessaire à l'envol suivant de la guitare.
De sa poche Nicolas extrait un harmonica. Le blues est au fondement de cet heavy-psyké que propulse Dätcha Mandala. S'en tire bien. Même si à mon humble avis, il lui manque cette respiration lente qui reste la caractéristique du blues. Ce milliardième de seconde où tout s'arrête, ce silence oppressif qui donne davantage de violence à la propulsion qui suit. Ce troisième temps invisible qui irrigue le blues de fond en comble et constitue le fil essentiel de la trame existentielle. Si prégnant chez les bluesmen de la première génération, écoutez par exemple Son House si ce que je dis vous paraît obscur. N'empêche que Nicolas emporte la conviction. Pieds nus sur la terre sacrée et vrombissante du blues il électrise l'assistance. Se démène, frotte sa basse sur les amplis, larsène à souhait, nous tire dessus avec sa guitare mitraillette, danse, virevolte, hurle, feule et soupire, avec conviction.

L'assistance n'est pas au diapason de cette furie scénique que déclenche peu à peu Dätcha Mandala. Les applaudissements seront de plus en plus nourris mais une fois le set terminé, on a l'impression que le public vient tout juste de réaliser la beauté rock'n'roll de la prestation à laquelle il vient d'assister et qu'il flotte dans l'air le regret de ne pas avoir davantage participé à cette fête. Les derniers morceaux seront particulièrement enlevés, Jérémy quitte sa guitare et exécute un impeccable poirier, peut-être pour nous indiquer qu'il faut savoir parfois entreprendre le monde sous un angle d'attaque différent...
Dätcha Mandala nous vient de Bordeaux. Se revendiquent de la musique des seventies. D'avant les Sex Pistols pour être davantage précis, de ce moment où la prégnance des racines dans le rock n'avait pas encore été bousculé par cette volonté hardcorienne de jouer plus fort et plus vite. Où l'on prenait le temps de respirer. C'est vraisemblablement ce parti pris de jouer à rebours des codes actuels en vigueur qui a un peu désarçonné la foule. Mais nous ne nous inquiétons guère. Dätcha Mandala possède l'énergie et la fougue qui lui permettront de triompher. Ont déjà fait leurs premiers pas sur la chaussée des géants.
POGO CAR CRASH CONTROL

Pas évident de succéder à Dätcha Mandala. Pas de danger, les Pogo ont décidé de couler le Titanic, alors prenez votre bouée de sauvetage et tâchez de survivre jusqu'à la fin du set. Noir total. Les guitares agonisent sur le sol. Et subitement c'est l'enfer. Les Pogo ont pris le contrôle et il est sûr que ça va crasher.
Batterie Godzilla et guitares filles du Kraken, en six secondes les Pogo ont détruit le monde. Mais le pire est encore à venir. Ne se fait pas attendre. Extirpe son abominable face dans le chaos que vomit le vocal d'Olivier. La bouche d'ombre éructe l'ultime menace. L'infâme Cthulhu sort du gouffre. Les Pogo ont brisé les chaînes qui cadenassaient la citerne immémorielle. Et dans la salle les sectateurs du démon qui attendaient depuis si longtemps l'interdite délivrance s'adonnent aux entrechocs d une sarabande dinosaurienne. Les Pogo ont compris l'essentiel, si le rock'n'roll veut exister c'est en tant que démiurge de la fureur. Tout autre voie serait celle du mensonge parménidien.

Torse nu et sueur reptilienne qui exsude de sa peau Louis Péchinot accentue les battements titanesques de Sebeth l'invincible. Il est la force héphaïstossienne de cette grimace douloureuse que la jeunesse offre comme un crachat de haine à la laideur de l'existence sociétale. Lola Frichet par les pincements cruels et graciles dont elle triture sa basse rappelle cette enfant blonde qui dans le poème de Victor Hugo se penche sur l'abîme pour savoir si l'oeil de Dieu est enfin éteint. Olivier Pernot et Simon Pechinot sont aux guitares ce que les toreros sont au taureau. Sacrificateurs et scarificateurs. Ils jettent des incendies de sel purulent sur la pulvérulescence des plaies de l'adolescence. Et cette voix imprécative dénonce et porte le fer dans les noeuds les plus intimes qui nous rattachent par des liens hojojutsiques au réel du monde et de nos contradictions.
Les Pogo ont une dimension en plus. Sont conscients qu'il faudrait trancher le joug directionnel de l'existence, par deux fois Olivier proposera de précipiter la barge au fond du fleuve. Il suffirait d'un grand va et vient collectif des deux bords pour déplacer le centre de gravité et susciter la farandole finale. Mais la transe pogotive de l'assistance refusera de se transformer en missile implosif d'intérieur. Parfois la coupure du désir sépare l'acte du fruit. Les temps ne sont pas mûrs et face à l'Innommable les plus courageux reculent.

Le set des Pogo Car Crash Control est comme une ondée de soufre rafraîchissante. Des images s'imposent et se superposent à nos rétines intérieures. A chacun la sienne, pour moi, un drakkar viking dévasté après l'abordage. Sur le quai, après le concert un petit groupe échange ses impressions. Certains redescendent se procurer leur vinyl. Le groupe s'impose. A ceux qui s'inquiètent du futur du rock.
JAMES LEG

L'on installe un gros orgue Fender Rhodes au milieu de la scène et face à lui l'on monte vitesse grand V, un kit de batterie. Les artistes seront de profil. Original binôme. James Leg et Mat Gaz entrent sous les applaudissements, deux grands types dégingandés, tous deux porteurs d'une longue crinière, autant celle de Mat lui tombe en soyeuses cascades bouclées sur les épaules, autant celle de James, graisseuse à souhait descend autour de son cou tels de visqueux serpents vénéneux.
Et le groove commence. Bien gras, soutenu par une batterie omniprésente. Soul à mort, James possède une belle voix éraillée. Le public marque la cadence, en extase, surtout les filles, faut dire que James présente une belle dégaine, l'a du charme et du charisme. Perso je commence à m'ennuyer. C'est beau, c'est bon, c'est bien, mais ça ne me transcende pas. La qualité mais pas le souffle qui vous emporte au paradis ou en enfer. James martyrise un peu toujours les mêmes touches de ses deux claviers. Unité de de ton, de lieu et d'action, mais au final l'ensemble finit par être monotone.
Quarante minutes, courte pause et reprise, n'y a que l'avant-dernier morceau qui s'envole un tantinet. Sinon l'on reste dans un mid-tempo musicalement correct. En y réfléchissant, c'est la programmation qui est boiteuse, après les deux grandes secousses des deux premiers groupes l'on tombe dans la mer des Sargasses. Soyons juste, l'assistance en est sortie satisfaite. Mais en poussant la conversation je m'aperçois que certains ont déjà dans le passé assisté à plusieurs de ses prestations bien meilleures...
Damie Chad.
( Photos : Brian Ravaux ImmortalizR )
BYE BYE ELVIS
CAROLINE DE MULDER
( Actes Sud / 2014 )
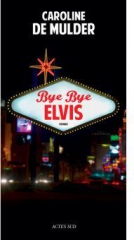
Froid de loup sur les trottoirs de Fontainebleau. Un panneau salvateur, Comptoir à Musique, s'offre à moi. Davantage de livres que de disques. Des CD mais pas de quoi faire le bonheur d'un rocker. Par contre les prix sont sympathiques entre deux et trois euros cinquante. J'en ressors avec ce roman. Pris par acquis de conscience pour Elvis, parce que les auteurs qui le brandissent en produit d'appel sur la gondole de leur couverture afin d'appâter le lecteur je préfère ne pas vous dire combien cela m'horripile. Un tour sur Wikipedia, Caroline De Mulder a écrit un livre sur le tango - scrongneugneu – mais aussi une thèse sur Leconte de Lisle, poëte majeur du dix-neuvième siècle stupidement dédaigné par nos futiles contemporains, j'en déduis que tout n'est pas totalement mauvais chez cette jeune femme. Donc je lis. D'une traite. Bien écrit, elle a du style, vous avez envie de savoir la suite. Parfois je suis hypocrite, comme vous je connais la fin. Enfin, juste la moitié.
Des livres de cet acabit nous en avons déjà chroniqué deux sur KR'TNT ! Complot à Memphis ( livraison 29 du 02 / 12 / 2010 ) de Dick Rivers. Très bon, qui raconte comment Elvis s'échappe du cirque parkérien pour pouvoir vivre une vie tranquilloute dans l'anonymat le plus complet, mais au tout début de sa carrière, et celui de Stéphane Michaka ( livraison 188 du 08 / 05 / 2014 ), Elvis sur Seine - la première mouture parut en 2011 et la deuxième en 2014 - qui envisage la même hypothèse de départ que Caroline De Mulder, la fausse mort d'Elvis qui pantoufle pépère dans la bonne ville de Paris. Z'oui, mais si vous devez n'en lire qu'un privilégiez celui-ci.
C'est comme dans les Histoires de Hommes illustres de Plutarque, deux vies en parallèle. Chacune suit son chemin, un chapitre sur Elvis, un chapitre sur John White. Et l'on recommence. En corollaire celle d'Yvonne veuve éplorée peu fortunée qui s'en vient trouver une place de gouvernante auprès de ce John White. Les fans d'Elvis ne seront pas perdus. La moitié du roman retrace la vie du King, il est facile pour les fans à simple lecture de retrouver dans quel livre notre auteur a pioché tel ou tel détail. Très honnêtement elle vous met sa bibliographie en fin de volume. De toutes les manières, la littérature est davantage un travail de réécriture que d'écriture. Les novateurs sont rares. Ce qui n'empêche pas d'appuyer sur certains aspects que l'on veut mettre en évidence. Pour Caroline De Mulder ce sont les origines prolétariennes d'Elvis. Fils de la misère, d'un père qui n'a qu'un goût fort modéré pour le travail – ce en quoi nous le comprenons - et d'une mère hyper-protectrice. Une espèce d'amour incestueux qui ne sera jamais conscientisé ni même charnellement esquissé. Le pauvre Elvis porte une autre croix, la culpabilité d'avoir survécu à son frère jumeau, d'avoir pris en quelque sorte la place de son aîné. L'aura du mal à se dépatouiller de cette existence qui ne lui appartient pas tout à fait. Surtout que la vie ne lui fait pas de cadeau, lui offre tout sur un plateau, la richesse, la gloire et surtout ce qui touche de plus près à sa condition charnelle d'être humain, les filles et les femmes. Comment refuser de tels dons du Ciel ! Elvis en consommera en grand nombre mais sa sexualité est dominée par l'obsession d'un désir de pureté qui n'est peut-être que l'échappatoire et l'expression d'une insoutenable contradiction, ne profite-t-il pas de faveurs indues ? Les filles s'offrent à lui, mais l'aiment-elles pour Lui ou pour son statut iconique à l'origine dévolu à son frère ? Et pourquoi Dieu a-t-il permis cette substitution ?

Pour John White, tout est beaucoup plus simple. L'a une personnalité, des traits de caractère, une corpulence, une richesse, une addiction médicamenteuse qui ne laissent aucun doute au lecteur. Ressemble à s'y méprendre à Elvis Presley. Ce ne peut être qu'Elvis. La seule qui ne s'en aperçoit pas, c'est évidemment cette godiche d'Yvonne. Restera plus de vingt ans auprès de lui. D'employée elle passe au rôle de mère protectrice ce qui pour Elvis équivaut à...
Un journaliste rock lui ouvre les yeux. Mister White n'est autre qu'Elvis, trop tard, John White a disparu et... lisez le bouquin pour savoir. Dick Rivers n'a-t-il pas sorti un disque qui se nomme L'Interrogation ? Nous touchons ainsi par l'entremise de Caroline De Mulder aux vertus de la littérature qui n'est pas de fournir les réponses aux questions que de prime abord vous ne vous seriez pas posées ainsi, mais de vous pousser à vous interroger sur les atermoiements du possible. Ô mon âme n'aspire pas à l'immortalité... début de cette citation de Pindare que Valéry plaçait en exergue du Cimetière Marin. La mort nous ferait-elle davantage question que le sexe à Elvis ?
Damie Chad.
04/01/2017
KR'TNT ! ¤ 310 : BLUES PILLS / JUSTIN LAVASH / POGO CAR CRASH CONTROL / MICHEL LANCELOT / NEGUS
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 310
A ROCKLIT PRODUCTION
05 / 01 / 2017
|
BLUES PILLS / JUSTIN LAVASH / POGO CAR CRASH CONTROL / MICHEL LANCELOT / NEGUS |
Les Blues Pills tombent-ils pile ?
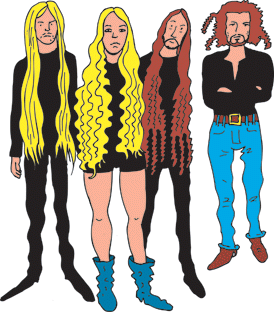
Oui, on peut dire ça comme ça : les Blues Pills tombent bien pile. Voilà un groupe sorti de nulle part qui non seulement se retrouve en tête d’affiche d’un concert subventionné, mais qui en plus joue dans la grande salle, un privilège qui est d’ordinaire réservé aux artistes téléramés bon chic bon genre. On a remarqué depuis un certain temps que plus le ventre du rock est mou, plus ça plait. On a le choix entre deux solutions : soit l’accepter, soit dire non et continuer de courir les petites salles trash où on ne mesure pas les décibels avec le fucking appareil.
C’est donc par simple curiosité qu’on se retrouve au concert des Blues Pills. Le hasard fait parfois très bien les choses, puisqu’une fille arrive avec une pinte à la main et trébuche. Elle renverse sa mousse. Ouf ! On renoue avec ce bon vieux trash qu’on aime tant : la flaque de bière et les semelles qui collent. Mais personne dans les parages n’ose allumer un spliff. Les gens maintenant sont bien dressés. On ne doit plus être très nombreux à rouler avec un gros nez rouge. Quelle époque !
Le vrai souci, c’est qu’on a déjà les oreilles chauffées par Kadavar, le trio poilu qui jouait en première partie. Nos amis les Pills vont-ils pouvoir monter d’un cran ? Ça paraît plus qu’hypothétique, car mine de rien, il vaut mieux éviter de jouer après un power-trio comme Kadavar. On pourrait disserter à l’infini sur la sauvagerie des programmations. La meilleure illustration de cette tare, c’est probablement un concert des Demolition Doll Rods à l’Abordage. Ce soir-là, on les fit jouer AVANT les Black Keys. Incroyable ! Aucun groupe à l’époque ne pouvait rivaliser de classe, de son et tout ce qu’on veut avec les Demolition Doll Rods, et surtout pas les Black Keys qui jouaient encore une sorte de punk-blues professoral, du genre regardez-les gars comme je joue bien de la guitare vintage, alors que Margaret et Dan rallumaient le brasier du Detroit Sound. On ne rigole pas avec ces choses-là. Et paf, les pauvres Blues Pills se retrouvent dans le même type de configuration. Ils montent sur scène APRÈS un power-trio qui vient en droite ligne de Blue Cheer et de Sabbath. Les Blues Pills eux viennent en droite ligne de rien. Ils jouent un rock très seventies et bien foutu, c’est vrai, mais qui sonne comme tous les albums des seventies qu’on achetait et qu’on ne réécoutait jamais, parce qu’ils n’avaient qu’un intérêt anecdotique. La survie de tous ces mauvais albums qu’on payait deux livres dans les second-hand shops de Golborne Road ne tient plus aujourd’hui qu’à un fil : la spéculation. On bâtit aujourd’hui des fortunes en trafiquant tous ces mauvais disques. Mais comme dirait l’autre, ceux qui les veulent et qui mettent un billet, on ne va pas les en empêcher, hein ?

Alors les voilà. Ils arrivent sur scène, avec leurs cheveux longs et leur look seventies. Le guitariste Dorian Sorriaux a sur scène la même tête à claques que sur les pochettes. Il joue sur une SG avec un style très doux et en même temps très présent, et pas mal de coups de wha-wha, comme le veut la loi du genre. Ce mec a des petites manies qui agacent un peu au début, comme de lever le bras droit chaque fois qu’il joue un bout de phrasé, mais il finit par s’imposer. On comprend qu’il n’est pas là par hasard. Sa physionomie bizarre ajoute un brin de mystère. Avec son visage fermé de petite gouape pasolinienne, il semble venir d’une autre époque, celle du Decameron de Boccace, par exemple. Ou encore d’une cave du Palais du Saint-Office, au temps où on y questionnait l’hérétique.

La bête du groupe, c’est le bassman Zack Anderson, un ex-Radio Moscow, et lui, il fait pas mal de ravages sur sa Thunderbird. Extraordinaire bourlingueur de drives ! Il faut quand même se souvenir que dans les années soixante-dix, les bassmen étaient souvent exceptionnels. Pour jouer de la basse dans un groupe, il fallait être aussi bon que le guitariste. Zack Anderson vient de cette école, celle des Jack Bruce et des James Dewar, des Phil Lynott et des John Entwsitle.

Et puis on a la petite chanteuse, une Suédoise qui s’appelle Elin Larsson. Blonde, bien sûr. Elle arrive sur scène vêtue d’un monokini-short noir. On croit qu’elle est pieds nus, mais non, elle porte un collant sous son short. Et puis, elle se met à faire du sport sur scène et ça tourne vite à la farce. Elle saute comme si elle faisait des exercices de gym, on dirait qu’avant de chanter, elle songe à perdre du poids. Son jeu de scène est assez grotesque, mais elle s’impose par sa voix. À certains moments, elle shoute comme une black et ça redevient intéressant, car on pense à des shouteuses comme Maggie Bell ou Elkie Brooks qui elles aussi savaient pousser des pointes, dans les années soixante-dix.

D’ailleurs c’est marrant de voir revenir ces chanteuses, car les albums de Vinegar Joe et de Stone The Crows font partie de ceux qu’on ne réécoutait jamais et qui finissaient par dégager.
Les Blues Pills parviennent à s’imposer, en dépit de quelques petits aspects caricaturaux, mais au fond, ce n’est pas méchant. On ne peut pas demander à tous les groupes de monter sur scène avec la prestance d’un Cyril Jordan. Ce groupe finit par forcer la sympathie en créant son monde, mais aucune chanson ne frappe l’imaginaire. Leur prestance se limite à un son, mais ils n’ont pas de hits, à la différence des Midnight Scavengers qui eux en ont, mais personne ne le sait.

Le spectacle n’est pas que sur scène. Il est aussi dans le public. Nous voilà sur la barrière, coude à coude avec LA fan, la vraie, une jeune femme brune à lunettes, smartphone à la main, qui connaît tous les cuts par cœur, qui traduit à son copain les commentaires de transition que fait Elin Larsson, et qui applaudit à chaque fin de morceau en explosant de joie. La magie du rock reste bien réelle, puisqu’elle rend toujours des gens heureux, et c’est bien là sa raison d’être.
En deux ans, ce groupe américano-franco-suédois a enregistré deux albums, Blues Pills et Lady In Cold. Chaque album s’accompagne d’un DVD. Le premier propose un concert filmé en Allemagne et le deuxième sent l’arnaque, car il s’agit aussi d’un concert filmé en Allemagne à la même époque, avec quasiment les mêmes morceaux.

Le hit du premier album s’appelle «Gypsy», une fantastique explosion de soul-rock - I’m a gyspsy/ That’s what I am - Elle gueule aussi pour de vrai dans «Astral Plane» et dans l’«High Class Woman» qui ouvre le bal. C’est le gratté de basse bien mixé qui fait le charme du cut. Elin Larsson reste très saute-au-paf des barricades dans sa façon de chanter, avec une voix verte à la Savage Rose. Et puis on note une belle facture guitaristique et aventurière. On sent un son et une vraie volonté d’en découdre. L’autre gros cut de l’album s’appelle «Jupiter», joué au stomp, bardé de son et whawhaté dans l’esprit de Seltz. Elin Larsson fait toujours sa Slick cosmopolite, elle lance un how this world should have been avant de plonger dans un abîme de son. C’est excellent car balayé aux quatre vents, intense et préempté dans les pires conditions événementielles. On aura aussi un faible pour «Black Smoke» attaqué au boogie blues dès le second couplet, et puis après une crise nerveuse, ils retombent dans l’apathie des hippies. Ils jouent avec les extrêmes, l’eau et le feu, le sucré et le salé, le pire et le meilleur, ils se paient de violentes crises de fièvre jaune et rallument au passage les vieux braseros de la toundra. Ce guitariste est un fin limier. Il fait aussi pas mal de ravages dans «No Hope Left For Me». Il en sort grandi, en guitariste puissant et valeureux. Dans le film qui accompagne ce premier album, il joue sur une Flying V. Elin Larsson fait sa Maggie/Janis/Grace en robe longue et le visage du bassman Zack disparaît sous une véritable cascade de cheveux ondulés. Ils sortent une version solide de «Devil Man», le cut qui se rapproche le plus de ce qu’on sait du blues-rock des seventies. Quand on voit ce groupe jouer sur scène, on comprend à quel point les années soixante-dix sont loin, c’est-à-dire sans lien avec notre époque. Sociologiquement, tout a changé, les comportements, les mentalités, les façons de se cultiver. Voir ce groupe jouer sur scène permet de voir à quel point le rock peut parfois devenir anecdotique.

Il n’empêche que Lady In Gold est un excellent album. Le morceau titre qui ouvre le bal sonne comme un hit. Elin Larsson va droit au but, avec une niaque impressionnante. Rien de plus admirable que la puissance d’une femme. Les Pills rallument les brasiers et lors du final éblouissant, Elin Larsson monte au créneau. Coup de génie avec «Bad Talkers», une pop r’n’b bien popotinée et jouée à l’étuve, presque stompée. On croirait entendre Merry Clayton ! Notre petite Suédoise est très forte. Elle ramène toute l’énergie de «Gimme Shelter» et relance aux hey hey ! Admirable. Rien que pour ce cut, l’album vaut largement l’emplette. On trouve aussi du climat chauffé à blanc dans «Little Boy Preacher». Ils sont sûrs de vaincre, alors ils jouent fièrement. Quelle fabuleuse shouteuse ! Comme on le disait à une autre époque, rock’n’roll is here to stay ! Encore de l’éruption en pagaille dans «Burned Out», littéralement chauffé à blanc. Ils sont tellement bons qu’il intensifient aussi à l’extrême un balladif comme «I Felt A Change». S’ensuit un «Gone So Long» amené au pinacle de la débâcle, charrié dans une dégelée de son qui grimpe dans les Andes jusqu’au temple du soleil. C’est radieux, puissant, bien intentionné, au service du peuple qui en a bien besoin. Il semble que ce groupe soit bienvenu, on les sent sincères et doués. Encore du fabuleusement hot avec un «You Gotta Try» tellement explosif qu’il finit par exploser, coïtal en diable et drivé vers l’enfer. Franchement, on se goinfre des gueulantes d’Elin Larsson. S’ensuit un «Won’t Go Back» tout aussi fiévreux, mené par cette harpie pleine de jus. Les deux derniers cuts de l’album vous enverront au tapis, si ce n’est pas déjà fait. «Rejection» sonne comme un stomp de r’n’b, mais le plus décidé qui soit. Ils nous pulsent ça à l’admirabilité des choses, dans la puissance de la démence et pour corser l’affaire, le batteur double. On retrouve enfin l’énergie de «Gimme Sheter» dans «Elements & Things». Tout vient du ventre du rock et ça gicle en direction du firmament. Si les Blues Pills deviennent énormes, ce ne sera pas uniquement à cause de cette ridicule mode d’un retour aux seventies.
Signé : Cazengler, Bouse Pill
Blues Pills. Le 106. Rouen (76). 29 octobre 2016
Blues Pills. Blues Pills. Nuclear Blast 2014
Blues Pills. Lady In Cold. Nuclear Blast 2016
*
Au secours ! Je suis englué dans un ramassis de jeunes bonnes femmes en extase devant les légumes d'un producteur bio. Sur le marché de Mirepoix. Moi la contemplation des potimarrons, c'est avec modération. Mais où que je me tourne d'énormes cabas ventrus me barrent le chemin. Je suis perdu, condamné à poireauter sans fin. C'est alors que Dieu a entendu ma détresse. Enfin plutôt le Diable qui se faufile dans le conduit auditif de mes oreilles. De rocker. Non, ce glapissement, ce n'est pas un orgasme féminin suscité sur l'étalage par la raideur écologique d'un radis noir, mais bien le glissement d'un tube métallique sur les cordes d'une acoustique. N'ai plus qu'à suivre ce fil sonore et providentiel pour m'extraire de cette gluance légumière pour me retrouver devant mon sauveteur.
JUSTIN LAVASH
Ah, la vache ! L'est beau comme un dieu grec. Qui a beaucoup vécu. Une gueule de baroudeur taillée à la serpe et un sourire désarmant. L'on sent le gars à qui on ne la fait pas. Un rouleur de bosse. Un boss. Et une belle voix en plus. Toutes les expériences de la vie accumulée, mais pas du tout usée, au contraire, prête à mordre dans tous les fruits de la passion qui passeraient à sa portée. Chante le blues. Le vrai celui qui perle comme les gouttes de sang des colères non rentrées et des fureurs jaillissantes. Et les doigts affairés qui courent comme des mains de marins sur les élingues les jours de déglingue et de naufrage. Miaule en slide. Sans fin. Picke en as. Six cordes, une cassée, et une orchestration ébouriffante. Un vocal qui monte et descend le toboggan des émotions. Ne fait pas chaud sur cette place centrale, mais elle vous brûle la peau et l'âme.
L'on ne s'attarde guère autour de lui, because aglagla, mais les oboles de deux euros pleuvent dans son étui de guitare. Je lui prends un CD – voir ci-dessous – et échangeons quelques mots, anglais qui vit à Prague mais qui passe selon d'affectives raisons régulièrement à Mirepoix – deux concerts prévus dans les environs, pas de chance, je serai à ces dates proximales retourné dans ma Brie ni côtière ni natale – une espèce de hobo des temps modernes qui a choisi la marge et les pistes ombreuses de la libre existence.
PROGRAMMED / JUSTIN LAVASH

Fistfulla Snake / The Story so Far / Programmed / EZ in CZ / Just Before / Meditation Gong / This is Now / Gonna Raise A Racket / Alittle too Soon / Affluenza.
Justin Lavash : guitare, vocal / Ian Kelosky : programmation / David Landstof : drums / Beata Hlavenkova / Karl Kwashivie : guitar / Mike Kyselka : harmonica / Stepan Janousek : Trombone. Choeurs et vocal : Kristina Zakuciova / Kristine Bornholtz / James Motherdale / Joe Cook
Enregistrement : Juin - Juillet 2016 / Subs Studio / Prague.
Belle pochette cartonnée openfield avec livret des paroles.
Fistfulla Snakes : Peux faire n'importe quoi avait déclaré le Roi Lézard. O. K., mais quoi au juste ? Un demi-siècle après Justin Lavash nous apporte la réponse. On la connaissait déjà, mais tout l'art gît dans la manière de la signifier de façon crédible. Attention, c'est du condensé, une poignée de secondes et de serpents, mais des méchants genre de ceux qui se dressent sur la tête de la Méduse chez Caravage. Vous avez le lieu et la formule, l'essentiel et le superflu, le ciel et l'Enfer, le mojo, l'électricité et les canines du crocodile. Du pur Lavash mais la force souterraine d'un Howlin' Wolf. The Story so Far : instrumental, presque joyeux, une bourrée auvergnate martelée comme quand l'on tire la langue à son ennemi pour le narguer, la slide qui grimace comme une gargouille d'église. Programmed : changement de programme. Le vocal reste chargé d'ironie et l'orchestration résonne comme les cloches à la sortie des mariés, oui mais les paroles démentent cette bonne jovialité, notre monde court à l'abîme, nous nous déshumanisons, des idéologies meurtrières s'emparent des commandes de notre cerveau, sourions, nous sommes filmés, tous devant la caméra du fascisme qui ne rampe plus. La voix se change en message radio. Attention à l'infantilisation de nos âmes. EZ in CZ : Historic blues, le passé de la République tchèque défile sous nos yeux. Politic blues. L'on se trimballe des valises lourdes à porter, nazisme et communisme, mais le présent n'est guère brillant, pourtant Justin avoue l'inavouable, pour lui la Tchéquie est une terre où planter son tipi même si ce n'est pas facile d'y vivre. Just Before : slide paranoïaque, part dans tous les coins. Mais en fait c'est plutôt une attaque schizophrénique. Le rêve qui se barre d'un côté et la réalité qui s'enquille une mauvaise direction. La musique devient un gros trait noir interminable qui raye. All the good is goin'gone. Groove Total : En français dans le texte pour que la subtile bastonnade de la réalité n'échappe point à votre vigilance. L'humanité s'effrite, les banques ne vous laisseront que les os pour pleurer. Grève ou groove. Ne vous trompez pas dans vos choix. Meditation Gong : peu transcendantale. Ne s'agit pas de laisser passer. Plutôt médication que méditation. La pression augmente dans les artères. La batterie s'éclate et les choeurs coagulent votre sang. Marche funèbre endiablée. Rien ne tombe. This is Now : C'est maintenant et pas après, le rythme devient fou, faut arrêter de tourner en rond devant les millions de solutions qui se pressent dans votre tête, la musique est presque froissée, se transforme en comptine enfantine pour mieux être hachée sur les cymbales d'une espèce de cantique de noël qui confine à la folie. Gonna Raise A Racket : le dernier chant d'espoir, pratiquement à cappella. Plus de grain à moudre. A Little too Soon : electronic sound, tout fout le camp un peu trop tôt, une manière de dire que rien ne va plus, ni l'estime de soi-même ni l'amour. Rythme précipité, le robinet d'eau chaude a la tiédeur des larmes du passé qui s'enfuit. Douche froide des amers constats. La guitare larmoie. Pas de quoi pleurer non plus. Affluenza : Joie et airs de mirliton. Tout va bien. Les filles du backing vocal s'en donnent à plein choeur, les boys ont du fric plein les poches. Le monde danse sur un volcan. Ce n'est pas une plaisanterie. Le disque se termine ici. Attention aux fissures dans les murs.

Ne m'attendais pas à un truc si novateur, si jouissif. Justin Lavash ne nous refait pas le coup du guitariste imparable. N'est pas le dernier puriste du blues. L'envoie aux orties le monstre sacré, l'intouchable. Le malmène salement. Pas de respect pour les vieilles lunes. Fussent-elles bleues. Se balade dans notre modernité. Pas belle à voir. S'agit plus de se contenter d'un fil de fer tendu entre deux clous. Etrangement ce bricolage m'évoque les distorsions que Led Zeppe faisait subir au folk sur son volume trois. Pas d'apparence, mais l'esprit. Le monde est devenu plus complexe. Les couleurs du serpent n'ont jamais été aussi rutilantes, aussi flashantes. Aussi fascinantes. Contre ses anneaux puissants, vous êtes désormais désarmés. Lavash possède son arme secrète, la dernière. L'ironie, qu'il inocule dans le timbre de sa voix. Brouille les pistes d'étranges sonorités. Rien n'est plus sublime que la catastrophe. Dernière valse sur le beau Danube blues.
Damie Chad.
CONSENSUEL
POGO CAR CASH CONTROL
( Clip Officiel / Romain Perno )

Rien de plus Consensuel que les réveillons de fin d'année. Surtout quand le gentil papa Noël descend de la cheminée pour mettre des milliers de cadeaux dans vos petits souliers. Les Pogo Car Crash Control ont décidé de donner leur version de ces festivités. Sous la direction de Romain Perno qui pousse le groin de sa caméra jusqu'à les transformer en Pogo Car Trash Faustroll. L'histoire commence bien. Une famille unie comme les quatre doigts de la main qui boustifaille à en vomir. Sur la nappe. Ce n'est pas le plus grave. Tout se passe dans les yeux. Ces miroirs phantasmatiques qui trahissent haines et désirs rentrés. Cette douce cellule à la base de notre société est un noeud de vipères. Lubriques. Âmes sensibles s'abstenir. Cela commence comme une grosse farce. Rien ne vous sera épargné. Même pas le foie gras transformé en merde de chien. Ni le crime, ni le viol, ni l'inceste. Le carnaval tourne au burlesque. Grand guignol et stupre néronien. Mais ce n'est pas le plus grave. Romain Perno nous grise d'un grésil d'images tournoyantes. La réalité est une fiction loufrocke. Suffit de faire un tout petit peu attention pour s'apercevoir que derrière le vernis des apparences, tout n'est que tumulte et fragmentations, fracas de miroir brisé coupants et saignants. Tout est parfait si ce n'est ce cadavre de dinde qui fait signe que quelque chose s'est détraqué dans nos sociétés d'abondance. La rigolade au service de la méditation métaphysique. Question essentielle : au-delà de la mort pourquoi le sang du Père Noël est-il d'un rose aussi cru que le saumon fumé ? Champagne pour tout le monde. Cruauté pour les autres. Vous n'êtes pas obligés de regarder. Le monde dans lequel vous habitez n'est pas toujours beau à voir. A rocksommer sans modération.
Damie Chad.
MICHEL LANCELOT
LE JEUNE LION DORT AVEC SES DENTS
GENIES ET FAUSSAIRES
DE LA
CONTRECULTURE
( ALBIN MICHEL / 1974 )
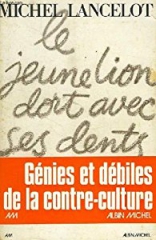
C’est chaque fois pareil. Tous les dimanches matin, sur la brocante. Je prends deux ou trois bouquins de poche à un euro, et lorsque je paie, la tenancière du stand me dit : attendez, je vais vous en rajouter un peu. Mais cette fois-ci elle en a rempli à ras bord une grosse poche plastifiée. Me suis traîné le sac lourd comme le barda d’un légionnaire romain toute la matinée. De retour à la maison, j’ai exploré le coffre aux merveilles. Une collection complète du Point ( heureusement que le Seigneur qui nous aime beaucoup a inventé les bennes à ordures pour nous débarrasser de ces horreurs ), une espèce d’in-folio géant, genre bible en exposition sur les offertoires dans les cathédrales qui s’avéra être un roman de quinze cent pages, quelques babioles de moindre envergure et oh! Tiens ! Surprise, un bouquin de Michel Lancelot. L’est mort, pas longtemps de cela Lancelot et je doute que son nom dise quelque chose aux jeunes générations. Officiait tous les soirs sur Europe 1, entre 1968 et 1974. De la bonne musique, de la pop music comme l’on disait à l’époque, mais ce n’était pas le plus important, le plus intéressant se passait entre les disques, Lancelot parlait de réalités inatteignables, San Francisco, les hippies, la beat generation, évoquait des personnages dont souvent on entendait causer pour la première fois, avait ses invités qu’il interviewait avec passion, Michel Lancelot fut ce que l’on appelle un passeur. Le Jeune Lion Dort avec ses Dents ( proverbe bantou ) est le troisième d’une trilogie qui débuta avec Je Veux Regarder Dieu en Face, un titre qui m’a toujours horripilé - comme s’il n’y avait pas des milliers de choses bien plus passionnantes que ce stupide fantoche - consacré au phénomène hippie et Campus qui pose le problème violence /non violence… faut dire qu’en la France de ces douces et folles années l’était temps d’arrêter l’incendie allumé par une jeunesse peu studieuse et en révolte… Un bel exemple à suivre en ce bas monde où la police est partout et la justice nulle part.

Que faire ? Comme ne disait pas Lénine. C’est que si l’on refuse la violence, la voie est étroite pour tous les insatisfaits du Système que Lancelot nomme la Machine. L’a sa sortie de secours toute prête. Son nom est écrit sur la porte. La Contre-Culture. Je vous admire, déjà vous êtes en train de tirer sur un joint, un vieil exemplaire d’Actuel sur les genoux tandis que derrière vous grésille un trente-trois tours du Grateful Dead. Rangez votre panoplie. Lancelot nous refait le coup de Greil Marcus devisant sur les Sex Pistols en 1986 ( voir KR’TNT ! 136 du 21 / 03 / 2013 ). Ne soyons pas chronologiquement stupide, c’est à croire que Greil Marcus aurait feuilleté Le Jeune Lion Dort avec Ses Dents avant de se mettre à rédiger son Lipstick Traces.

L’arrive un moment dans la vie où les illusions vous tombent du cerveau comme les feuilles des arbres en automne. La Contre-Culture n’est pas née en Amérique, ni à Memphis, ni à New-York, ni à Los Angeles, entre 1956 et 1966. Même que ceux qui l’ont initiée ne savaient même pas qu’un jour viendrait au monde un truc tumultueux que l’on appellerait le rock and roll. Notre orgueil de rocker en prend un coup, mais cocoricou, la Contre-Culture vient de chez nous. L’a commencé juste à côté en Suisse, mais les principales batailles se sont déroulées à Paris.
Dada, Lettrisme, Surréalisme, sont les trois premières mamelles du ventre de la bête féconde. Rien à voir avec trois regroupement successifs d’artistes en mal de reconnaissance. De jeunes gens qui se cacheraient derrière un manifeste plus ou moins faussement séditieux pour gagner leur place au banquet de l’écuelle littéraire. Le propos est beaucoup plus sérieux. S’agit de bouter hors du champ de la rationalité affligeante les vieilles lunes de la Culture Académique, celle qui s’achève, comme La Montagne Magique de Thomas Mann sur les champs de bataille de la guerre de quatorze. Rejeter à la mer de l’oubli vingt-cinq siècles d’une civilisation qui a démontré l’inanité de ses principes moraux soi-disant supérieurs. Briser l’aiguille de la boussole, se laisser dériver dans les zones interdites du non-sens, du rêve, de la folie… L’analyse de Michel Lancelot est prémonitoire en le sens où il présente l’entreprise de ces pionniers comme un travail méthodique de destruction qui vise autant à dynamiter les assises sociales de l’être humain que la base idéologique de cette grotesque marionnette infatuée d’elle-même qu’est l’animal-homme qui s’est auto-institué le Sujet Pensant de l’Univers. Lancelot nous présente la tâche effectuée par ces avant-gardes poétiques de la première moitié du siècle précédent en des termes qui conviendraient pour décrire le travail de dé-construction opéré par la génération derridienne en fin de gestation dans le moment où il écrit son livre.
Reste que la littérature se doit de mettre ses théories à l’épreuve de la vie. S’étaler pompeusement sur des pages et des pages est facile, mais il est utile d’en sortir pour transformer le monde. Lancelot possède son as de pique soigneusement arboré sur sa manche. S’il privilégie tout au long de son livre le lettrisme c’est que celui-ci a engendré un bâtard qui sut faire parler de lui. Le Situationnisme en tant que déclic théorique qui déclencha Mai 68. C’est ainsi que l’on aime à présenter les évènements. Z’oui, mais n’empêche qu’il y eut un autre foyer d’infection.
En Amérique. Ce que l’on célèbre aujourd’hui sous le nom de Beat Generation. Sacrés amerloques, tirent toujours la couverture à eux. Ont recréé, tout seuls, dans leur coin lointain, ce que les pauvres européens avaient mis un demi-siècle à faire émerger. Un phénomène de génération spontanée ? Point du tout. De 1959 à 1963, y a du beau monde qui se presse à Paris pour écouter les lettriques lectures d’Isidore Isou.

Parmi ces aficionados quelques noms connus, des peintres comme Liechenstein et Indiana, futurs rois du pop art, des écrivains reconnus de tous les rockers, Gregory Corso, Allen Ginsberg, William Burroughs, les chantres de la Beat Generation. Les Anglais qui n’en sont jamais à un coup de Trafalgar près adopteront une jeune japonaise qui fréquentait ces lieux de perdition mentale, destinée à devenir la compagne d’un célèbre prolétaire, Yoko Ono.
N’est pas question de se disputer pour savoir qui possède la plus grosse beat générative. Le mal vient de plus loin que le siècle précédent. Lancelot remonte les escaliers de l’Histoire, descend les marches jusqu’à la Rome Antique. Ce n’est pas qu’il soit un émule de Jules César. Nous entraîne dans le stupre de la décadence. Hélas, nous n’avons pas droit à quelques scènes de banquet orgiaques, nous ne sommes pas là pour nous amuser ou nous rincer l’œil à grandes eaux, mais pour apprendre à identifier nos ennemis. Le christianisme, son moralisme étroit, son puritanisme puant, son étroitesse idéologique qui brûla bien plus de livres que ne le firent les Nazis… Histoire ancienne diront les esprits conciliants. Pas tant que cela. Rappelez-vous les mouvements de protestation contre la guerre au Vietnam, dans les universités américaines. Comme par hasard, très vite fleurit sur les campus de la docte America les Jesus freaks qui s’employèrent à répandre les préceptes de non-engagement politique prêché par le dieu d’amour et de paix… Faisons vite une croix sur ce cauchemar de résignation pateline.
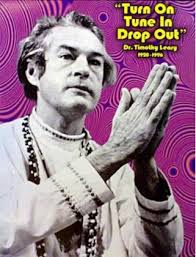
La Contre-Culture n’est pas là où on l’attend. La fumette est un agréable passe-temps à ne pas confondre avec les expériences du LSD prônée par Timothy Leary. Ne s’agit pas de se faire sauter la tête en quête d’une jouissance sans entraves. L’acide est un moyen de Connaissance, une gnose qui permet de gravir les arcs-en-ciel qui donnent accès à l’auto-divinité. L’interdiction de la drogue repose sur d’autres inquiétudes que la préservation de la santé physique de ces adeptes. Celui qui parvient à un niveau de conscience sur-élevée ne croit plus en les préceptes de la comédie sociale. Devient un ingouvernable, un incontrôlable sur lequel la loi commune n’a plus aucune prise. Il serait extrêmement dangereux pour un Etat que se développe une trop large frange de tels individus. Big Brother veille sur vous. Ne vous quitte pas de l’œil.
C’est dans les ouvrages de science-fiction d’un Bradburry ou d'un Philip K. Dick que se développera la critique la plus radicale des institutions. Une simple distorsion temporelle permet d’évoquer des problèmes ou de soulever des problématiques les plus actuelles. Retour en France, Lancelot évoque longuement Le Matin des Magiciens - plus d’un million d’exemplaires vendus, et l’aventure de la revue Planète qui s’ensuivit. Un phénomène éditorial qui ouvrit en grand les portes de l’ésotérisme à une génération avide de nouveautés. Le livre devint la Bible du mouvement hippie français, déclencha des prises de conscience et des décisions existentielles innombrables. Elargit le champ des possibles. Prudence, nous avertit Lancelot, confiez les plus hauts secrets, donnez les meilleures potentialités à un imbécile, il n’en ressortira que des imbécillités. Papa Freud devenu la tarte à la crème de la psychologie du pauvre.
Nous donne l’impression que la Contre-Culture n’est pas un mouvement de masse. Notre époque ne manquera pas de l’accuser d’élitisme ! Porte l’accent sur les novateurs, les Kandinsky qui font exploser les schémas de la représentation, les anonymes qui se servent du faible coût et de la maniabilité du super-huit pour s’emparer du cinéma. Est à l’affût des arts nouveaux : la bande dessinée qui prend son essor au tout début des seventies par exemple…
Quarante ans après, le bouquin date un peu. La bombe atomique ne nous fait plus peur. L’extinction de l’espèce humaine nous l’avons congédiée pour parer au plus pressé, ces fous dangereux qui attaquent nos petites personnes à coups de hache dans le train, nous nous méfions davantage de l’islam que du christianisme... Les Etats l’ont compris, l’important ce n’est pas la cause, mais que la peur continue à habiter les esprits. Le vieux lion a longtemps dormi, en se réveillant s’est aperçu que ses griffes étaient émoussées.
Damie Chad.
M’en a voulu à mort. Cette vieille baudruche crevée de dieu. N’a pas dû goûter mes blasphèmes. N’avais pas fini cette chronique depuis deux jours, qu’en entrant chez le premier bouquiniste venu mon œil fut attiré par une chatoyante couverture, à ne pas y croire, quel hasard saint Balthazard, quelle providence, négligemment posé sur un tas informel de bouquins, qui me regardait droit dans les yeux, de Michel Lancelot :
JE VEUX REGARDER DIEU EN FACE
( LE PHENOMENE HIPPIE )
( Albin Michel / 1972 )

La première édition date de 1968, en prise directe sur les évènements, n’y avait pas beaucoup de monde sur le coup à l’époque, à part Alain Dister de Rock & Folk que Lancelot cite avec respect à plusieurs reprises. Mais tout ce que je vous raconte ne vous intéresse pas, la question purulente vous brûle les lèvres, et Dieu dans tout ça, my dear Damie Chad ?
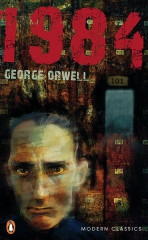
Il arrive. Tout doucement. Peut-être pas comme vous l’imaginez. Mais il ne va pas tarder à vous éblouir. C’est comme dans la Bible, d’abord vous aurez droit aux prophètes. Le premier a déjà beaucoup vécu. L’est en fin de course. Mais l’est le précurseur. L’enfonceur des portes qui n’étaient pas encore ouvertes. Un oiseau de mauvais augure. Nous promettait un futur peu rigolo, aux alentours de 1984. Un fachisme d’état menaçant. George Orwell a foutu les chocottes à deux générations. Ce n’était pas l’annonce de la dictature totalitaire qui les faisait flipper. Mais la date symbolique choisie comme titre de son roman, celle de l’alignement des planètes et de la fin du monde qui s’en suivrait. Tenez un discours politique clair et les imbéciles s’adonneront aux croyances délétères des ésotérismes les plus fumeux. En ces temps-là, on entendait dire que le cerveau d’Einstein n’exploitait que dix pour cent de ses capacités, Aldous Huxley était encore plus catégorique, quand on aurait trouvé le désherbant qui nettoierait les mauvaises herbes du bien et du mal qui encombrent la cervelle de l’individu, nous entrerions de plain-pied avec les réalités sur-jacentes de l’Univers.
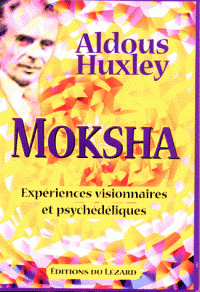
Le problème avec les intellos - fussent-ils de génie - c’est qu’ils parlent beaucoup mais agissent peu. Dieu comprit la nécessité de la venue de son deuxième prophète. Un mec bien, sous tous rapports. Un professeur d’université avec une liste de diplômes aussi longue que celle des commissions. N’aimait pas les cours magistraux. L’était pour les méthodes d’enseignement actives. Un théoricien certes mais doublé d’un expérimentateur de génie. L’avait tout compris, si vous voulez que les élèves retiennent, c’est à eux d’emmagasiner dans leur boîte crânienne les savoirs indispensables à d’utiles compréhensions. Possédait son outil magique, le mystérieux LSD 25, un produit miracle qui surmultipliait votre perception du monde, un déluge de couleurs qui s'abat sur vous et vos représentations rétiniennes qui se tordent dans tous les sens avec la vivacité synesthétique d’un élastique fou. Mais Timothy Leary ne se contente pas de noter scrupuleusement vos réactions. N’est pas un simple observateur. Cet homme est aussi un poète. Au verbe aussi étincelant que vos visions lysergiques. Un séducteur. L’on sent que Michel Lancelot est fasciné par ce bateleur de l’invisible. C’est que Leary n’y va pas avec le dos de la cuillère à glace. Vous sert la soupe à la louche. Ne vous promet pas un bref instant de plaisir, une sensation forte, l’escalade de l’Everest en tongs trouées les yeux fermés. Non, l’est affirmatif, si vous devenez un adepte de la consommation du LSD, vous finirez par apercevoir la lumière blanche. J’entends le rire des sceptiques qui appuient sur le commutateur électrique. A la fosse, bande de mécréants ! La blancheur à laquelle vous avez accès n’est autre que celle qu’entrevirent les Mystiques. La splendeur divine qui se révèle à vous sous sa forme la plus lumineuse. Oui, vous regardez Dieu en face ! Vous atteignez à la sagesse supérieure, à la connaissance suprême ! Vous ne trouverez jamais mieux ailleurs. Leary invente une forme nouvelle de psychologie ébouriffée, philosophico-expérimentale, une espèce de do it yourself à la portée du plus grand nombre, le psychédélisme.
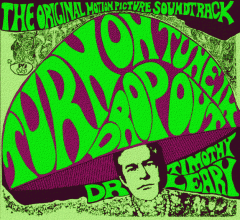
Contrairement à ce que l’on pourrait accroire, les allégations de Timothy trouvèrent crédit auprès de nombreux étudiants. Les USA sont un pays pétri de religion. Les générations d’après-guerre avaient un peu de mal avec le dieu d’amour de leurs parents sous l’égide duquel deux conflits mondiaux avaient défiguré la première moitié du vingtième siècle. De plus on en avait rajouté, une bombe atomique apocalyptique et une intervention au Vietnam qui se profilait à l’horizon des fins d’études. Les injonctions de Leary étaient davantage réconfortantes, laissez tomber votre existence de merde programmée dans les états-majors du Pentagone et des multinationales, quittez tout, transformez votre vie en une quête d’absolu, retirez-vous de la confusion et des tracas du monde, devenez les adeptes de la nouvelle religion de l’acide et vous mènerez une paisible vie de sérénité accomplie. Un message qui n’est pas sans rappeler les injonctions des premiers chrétiens qui tombait à pic dans le substrat christianophile de l’inconscient national…
SAN FRANCISCO 1966
La mayonnaise - ou plutôt la béchamel pour respecter le code de la couleur dominante - prit au-delà de toute espérance. Sur les campus la bonne nouvelle se répandit à la vitesse d’un éclair au chocolat blanc. Pour une fois que l’on était investi d’une mission supérieure, l’on n’allait pas laisser passer l’occasion. D’autant plus qu’il y avait des à-côtés sympathiques : refus de la violence, ouverture aux autres, amour tous azimuts. L’on possédait non seulement the miraculous drug, l’on s’adonnait à la pratique philosophique du sex, et dans leurs coins des groupes de rock and roll commençaient à mettre au point la bande son du mouvement. La sainte trinité était retrouvée.
L’année 1966 débuta sous les meilleurs auspices. L’été fut merveilleux. La population accueillit sans déplaisir cette jeunesse aux habits colorés qui squattèrent la quartier Haight-Ashbury Park. Pas méchants pour un cent. Sourires aux lèvres, vous offraient dès fleurs dès que vous risquiez une réflexion déplaisante, passaient leur temps à bavarder sur les pelouses. Dans les hauts lieux gouvernementaux l’on s’inquiétait. Cette jeunesse qui refusait d’entrer dans le moule social, qui dédaignait de participer à la guerre du Vietnam et puis cette drogue qui catalysait ces refus d’obéissance anarchisante… Inquiétant d’autant plus que les media amplifiaient le mouvement…
MICHEL LANCELOT
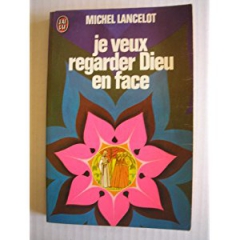
L’arrive un peu après la bataille. Tout est foutu. Le mouvement essaie de faire face. Pas à Dieu mais aux hommes. Les purs et durs fuient la nouvelle Babylone. Fondent des communautés à la campagne. Dans des coins perdus où l’on essaie d’inventer de nouveaux paradigmes existentiels. En 1968, il est trop tôt pour tirer un bilan sur ces expérimentations utopiales. Lancelot rentre en France, bien décidé à témoigner de ce qu’il a vu. N’est pas idiot, c’est qu’il écrit sur la corde raide. Aborde un sujet dangereux : celui de la drogue.
Comment n’en pas parler ? Et comment rester crédible ? N’est pas comme ces savants qui vous décrivent et dessinent par le menu les fameux dinosaures que personne n’a jamais vus. L’est un malin. Non, il n’a pas vu Dieu en face, ni de profil, mais il a pris du LSD. Le raconte dans les annexes. N’est pas un consommateur. Un expérimentateur. Un cobaye scientifique qui livre ses impressions mais aussi le rapport objectif des accompagnateurs qui ont programmé ces expériences. Peu affriolant. Ne se rappelle pas de grand-chose. Le paquet de lessive que vous avez acheté sur la fois des pubs à la télé et qui ne lave pas plus blanc que les autres. Fait suivre son récit de quatre exemples de very bad trips… des témoignages médicalisés qui ne sont guère incitatifs.
Se raccroche aux petites branches. Evoque l’art hippie. Pas vraiment emballé. Les fameuses affiches des annonces de concerts ne séduisent pas notre homme qui est un spécialiste de la peinture européenne. Pour la musique, l’est plutôt un aficionado du classique… L’est beaucoup plus intéressé par le détachement quasi monastique de ceux qui sont attirés par la spiritualité des pays d’Orient. Ceux qui partent pour l’Inde et qui en 1968 ne sont pas encore revenus… Les promesses n’engagent que ceux qui veulent y croire.
Le titre du bouquin est un peu tape-à-l’œil mais il n’en est pas moins intéressant. L’était difficile de faire mieux à l’époque me semble-t-il. Un document à chaud qui ouvrait bien des perspectives. Lancelot avait voulu comprendre son époque. Au plus près. Le livre démarre comme un essai, l’a été pensé avec le sérieux d’un pape hérétique, cinquante ans après il reste un document sans égal, rédigé au cœur même du désastre.
Damie Chad.
NEGUS N°2
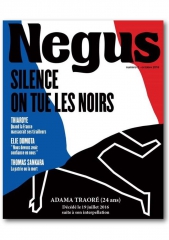
Ce qui s'appelle arriver après la bataille. Cette recension paraîtra alors que le ce numéro 2 de la revue devrait être retiré des kiosques en ce début d'année. Pour, espérons-le la mise en place de la troisième livraison. Nous avions présenté le premier fascicule ( voir KR'TNT ! 296 du 29 / 09 / 2016 ) et puis lassé d'attendre la deuxième parution, nous l'avons quelque peu oubliée. A notre décharge, elle n'a pas été vraiment mise en évidence dans les points presses que nous fréquentons. C'est en passant devant le bureau de tabac où je m'étais procuré le premier que l'idée m'est subitement venue de m'enquérir de son éventuelle parution. Sont allés me le chercher dans l'arrière-boutique. Ont peut-être trouvé la couve gênante : ce drapeau français qui vous arrache les yeux et le titre sans concession : Silence on tue les noirs. Pas étonnant si sur son facebook Negus invite systématiquement à chacun de leur post à s'abonner.
Negus ne pouvait pas passer sous silence le décès d'Adama Traoré suite à son interpellation par la police – tout le monde la déteste – donne la parole à sa soeur Assa Traoré qui mène un épuisant combat pour savoir enfin les conditions exactes de la mort de son frère. Police, Justice et Autorité sont bien embarrassées de ce cadavre de plus en plus encombrant. Une affaire à suivre.
Nous retrouvons la suite des aventures de notre couple suicidaire décidé à traverser l'Afrique du Sud en stop. On leur promet le viol et la mort dès qu'ils aborderont les townships grouillants de noirs assassins. Hélas, les prophéties se révélèrent vaines. Ne cachent point que parfois l'appréhension leur serre les fesses et qu'ils s'endorment sous la protection d'un couteau, mais même invités chez les autochtones tout se passe au mieux. Même pas étranglés en pleine nuit dans leur sommeil. De quoi désespérer de la noirceur humaine. Nos deux héros tirent la leçon de leur odyssée : les communautés blanches et noires qui vivent séparées, phantasment leurs peurs et leurs passés...
Retour en France, pardon en Guadeloupe, regard noir sur les méfaits de la colonisation passée et de la post-colonisation actuelle... L'on enfonce davantage le couteau dans la plaie avec la reproduction du discours de Thomas Sankara prononcé le 29 juillet 1987 au sommet de l'Organisation de l'Union Africaine. Une autre vision de l'Afrique libre et indépendante débarrassée de la tutelle de l'Occident. Des réalités et une vision si dérangeantes que trois mois plus tard ce président du Burkina Faso si politiquement incorrect fut promptement liquidé...
Passons sur les deux bandes dessinées qui accaparent trop de pages. La revue s'achève sur un long article consacré à 2pac. L'était déjà présent dans le premier numéro, mais cette fois-ci, l'on s'intéresse moins à sa musique et davantage à l'aspect politique de sa démarche. Negus poursuit sa marche en avant. Sont conscients - du moins nous le leur souhaitons - que l'expression laudative de la fierté noire tournera vite à vide, autant que les jérémiades victimaires, le salut réside en un projet politique qui n'est pas évident à définir. Pour le moment la revue s'enferme un peu trop dans le communautarisme. Ne s'agit pas de nier l'oppression subie par les peuples noirs, les pauvres et les opprimés sont de toutes les couleurs. Les riches et les oppresseurs aussi. Le racisme est un ferment de division des luttes des masses populaires savamment entretenue par la main-mise capitaliste sur les richesses et l'esprit corruptible des hommes.
Damie Chad.
14:38 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : negus n° 2, pogo car crash control, michel lancelot, justin lavash, blues pills


